Jean-Mary Couderc,
souvenirs d’un professeur tourangeau
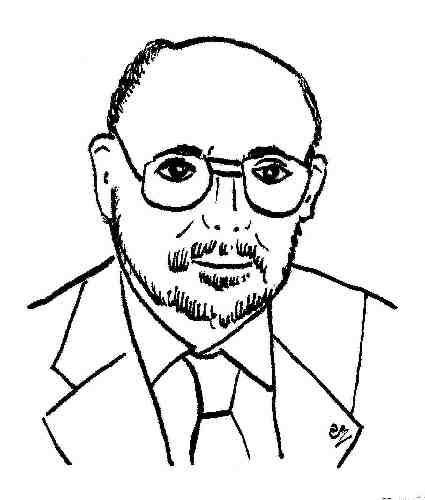
16èmes RENCONTRES LITTÉRAIRES
DANS LE JARDIN DES PRÉBENDES, À TOURS
Vendredi 29 août 2014, de 17 h 30 à 19 h
|
Jean-Mary Couderc, souvenirs d’un professeur tourangeau |
|
Lire la présentation de cette rencontre.
Lire la présentation de Jean-Mary Couderc par Catherine Réault-Crosnier.
Intervention de Jean-Mary Couderc
Introduction : le décor de mon enfance
Je suis né en Laponie en janvier 1939, c’est-à-dire dans le canton de Château-la-Vallière ainsi que l’a nommé, non sans humour, le comte Odart. En effet, ce dernier avait créé à Esvres, sur 1,5 ha, un collection de 479 cépages de vigne provenant de quatorze états du monde et avait demandé au conseil général une modeste contribution pour entretenir cette collection après sa mort, ce qui lui fut refusé sur le rapport du député de Chinon, Théobald Piscatory, conseiller du canton de Château-la-Vallière, d’où cette formule cinglante car la Laponie est un pays froid et sans vignes !
Je suis né dans ce canton, à Rillé, car c’était le premier poste double de mes parents instituteurs qui n’eurent point de cesse, avec le temps, de se rapprocher par étapes de la ville de Tours en particulier pour que je puisse rentrer au lycée à dix ans en classe de 6e. Rillé est une très ancienne baronnie d’Anjou, dans une frange orientale de la province angevine rattachée à l’Indre-et-Loire en 1791. Cela m’a permis d’écrire dans la préface de mon ouvrage en collaboration L’Anjou insolite que j’étais angevin.
Oui ! À l’est et au sud de Rillé, le paysage est triste et ultra plat, à l’emplacement de trois immenses étangs du XIVe siècle, plus ou moins bien asséchés dans le premier tiers du XIXe siècle. Et au-delà, vers le sud et l’ouest, on rencontre un vaste paysage de landes et de pinèdes qui m’a, dès le départ, fait aimer la Gâtine tourangelle et plus tard étudier sa végétation. Pendant la guerre, après les vacances, mes parents allaient en bicyclette (moi-même étant sur un siège derrière mon père) chez leurs amis Balland, propriétaires du moulin de Pincemaille sur le Lathan et je me souviens très bien du décor forestier. J’admirais à loisir l’étrange tableau coloré et odorant des bruyères sous les pins que ponctuaient de fausses oronges goguenardes et sans doute maléfiques.
J’ai toujours dans l’oreille le rocailleux parler des habitants d’alors disparu depuis longtemps et je donnerai cher pour entendre à nouveau parler une personne fréquentée pendant mes jeunes années.
Il me souvient qu’en 1969, j’ai cherché à revoir une voisine de ma maison natale, Madame Bodin, qui avait contribué à m’élever, aidant mes parents pris par la classe ou par le secrétariat de mairie. Veuve, elle s’était réfugiée, vraisemblablement pour des raisons économiques, dans une chaumière de plusieurs siècles à la sortie du bourg, route de Parçay. Je frappe, personne, je recule pour embrasser du regard la demeure délabrée quand une femme en robe et sarrau noirs brillants sortit et s’avança vers moi. Elle ne me reconnut point, je me nommais, ses yeux rouges s’embuèrent et j’entends cette voix à l’accent si particulier qui toujours m’émeut : « Oh ! Mon p’tit Titi, ch’u t’y contente de te revouerr ! ». Nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre avec beaucoup d’émotion, mais vous en dire plus est difficile.

I. Ma jeunesse
1) Deux mots sur ma tendre enfance
J’ai passé une partie de mon enfance chez ma grand-mère maternelle qui habitait rue du Docteur-Fournier. Elle était brodeuse et venait travailler chez une voisine et amie couturière qui habitait trois petites pièces sous les toits éclairées par trois tabatières. Je venais avec elles et me plongeais dans Marius et Ici Paris, les deux journaux humoristiques qui faisaient les délices de « Madame Germaine » ainsi qu’on appelait la couturière, et surtout dans le Petit dictionnaire Larousse, l’ouvrage indispensable pour ses mots croisés. Seules deux parties m’intéressaient : les planches hors texte sépias sur les arts encore que, jeune, certaines figures me faisaient peur comme la tête de Méduse, et, plus tard, les pages roses (« les pages rousses du petit Larose » comme disait Prévert). Les locutions latines me plaisaient fort et je ne savais pas encore qu’elles annonçaient à la fois mon attirance pour les écrivains latins et les grandes souffrances que je connus en essayant de les traduire ; en particulier en classe de 4e avec mon ami Perez, cachés derrière les grands cartons à dessin, au dernier rang de la grande salle de dessin du maître Dinzart sous les toits de l’aile nord du lycée Descartes. C’était l’époque où certains croyaient que le « Timeo Danaos et dona ferentes » de l’Énéide (II, 49) annonçait l’arrivée de Monsieur Timeo Danaos accompagnant sa femme doña Ferentes.
2) Évoquons rapidement mes études
Mes parents avaient obtenu un poste à Beaumont-la-Ronce en 1946, puis à l’école de Saint-Cyr-Périgourd en 1949, de manière à ce que je puisse gagner le lycée Descartes dès le 1er octobre, en faisant trois kilomètres en bicyclette puis un long trajet en car. Je fis plus tard l’intégralité des six kilomètres à vélo.
J’étais encore très jeune et naïf en entrant en classe de 6e. Ainsi après l’enterrement de ma grand-mère le 3 octobre, ai-je été mis en retenue le 5 pour n’avoir pas présenté – par ignorance – un papier justifiant mon absence.
Qu’allais-je faire après la philo ? J’étais bon en biologie humaine et j’ai pensé à la médecine, séduit par les exigences du diagnostic : trouver les affections les plus rares et les plus difficiles à détecter. Hélas ! je n’ai pu embrasser cette carrière !
Mon cousin m’emmena en salle de dissection pour voir si je tiendrais le choc ; aucun problème. Mais il avait dû avoir une crainte, car un jour qu’il décrivait l’agonie de son voisin cancéreux, je m’évanouis. J’avais déjà senti en biologie que je ne pouvais plus serrer mon stylo dans ma main lorsque dans certains cours on évoquait le sang et des blessures.
En 1956 au cinéma Olympia, à la première projection en Touraine d’une opération à cœur ouvert que je tenais à voir, je sentis la chaleur m’envahir, je sortis rapidement et m’effondrai dans le hall près des caisses. J’entendis, en me réveillant, une femme compatissante dire à son mari : « Qu’est-ce qu’il tient celui-là ! ». Ce fut sans doute une période de malaises vagaux qui disparurent d’ailleurs rapidement.
Comme disciplines de prédilection, il me restait encore la géographie, les sciences (19 en composition au second trimestre de la philo) et l’espagnol (19 au bac), je me suis dit : « Pas de problème, je ferai de la biogéographie en Espagne ». Je choisis donc la géographie en faisant à la fois propédeutique et hypokhâgne à Tours, la première année où cette classe supérieure fut ouverte à la demande de Pierre Verdier, célèbre professeur du lycée Descartes. C’est à Tours que je rencontrai Paul Fénelon, professeur de géographie, qui allait ensuite être mon professeur de géographie à Poitiers et mon premier directeur de thèse.
Après la propédeutique, poussé par mes parents qui en mesurèrent l’intérêt financier, je fis une demande pour être admis à l’« Institut de préparation aux enseignements du second degré » (IPES) qui venait d’être créé, ce qui me permettrait de toucher un salaire en étant étudiant en échange d’un engagement de dix ans dans l’Éducation nationale ; j’y fus admis le 1er octobre 1957 et je passais mes quatre certificats de licence en deux ans en 1958 et 1959. Dès l’été 1959, je préparai mon diplôme d’Études supérieures en Espagne et je passai le CAPES théorique en 1960.
3) En Espagne
J’adorais l’Espagne et sa langue et j’avais déjà largement parcouru le pays avec mes parents depuis 1953. En prévision de l’été de ma philo, j’avais demandé une bourse Zellidja dont le sujet était peut-être trop pointu : « Les églises pré-romanes du NO de l’Espagne ». Je n’ai pas été accepté mais je suis parti seul en Espagne et Portugal pendant un mois et demi, voyageant en auto-stop, en locomotive, en train etc. Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi mes parents avaient accepté que je parte seul à seize ans.
C’est le film « Terre sans pain » de Luis Buñuel qui m’avait donné l’idée du sujet de mon mémoire de maîtrise : mesurer l’évolution d’une région de la sierra de Gata située non loin de la frontière avec le Portugal et appelée Las Hurdes. En 1933 (date du film) c’était « La vergüenza de España » (la honte de l’Espagne) en raison de l’extrême pauvreté et de l’abandon de la partie haute de cet ensemble de cinq profondes vallées en V creusées dans des schistes cristallins très pauvres (d’âge silurien).
C’était un territoire presque dépourvu de terre arable où le régime de Franco venait d’ouvrir les premières routes et de créer les premiers « municipes » (villages pourvus d’une mairie) et les premiers cimetières.
À vingt ans, Gustave Flaubert voulait être muletier en Andalousie, moi je le fus en Estrémadure. Pour visiter les 470 km2 et les 10.000 habitants répartis dans les trente-sept villages contrôlés par cinq municipes, il me fallut cheminer avec un mulet ou un âne, mon sac à dos accroché à la selle. Quand j’arrivais aux premières demeures dont certaines aux toits couverts de dalles de schistes et sans cheminées, les femmes sortaient pour m’acheter des foulards ou des mouchoirs car, avec mon sac elles me prenaient pour un colporteur.
Certains hommes parfois méfiants, me voyant prendre des notes, pensaient et parfois me dirent, que je prenais des renseignements qui pourraient servir en cas de guerre avec la France.
4) En Alsace
Je choisis d’effectuer mon stage de CAPES à Strasbourg en 1960-1961 pour bénéficier des cours d’agrégation d’un professeur de géomorphologie alors très connu à l’université de Strasbourg : Jean Tricart. Quand je racontai pour la première fois à mes compagnons agrégatifs strasbourgeois que c’était la raison pour la quelle j’étais venu à Strasbourg, ils éclatèrent de rire d’autant qu’un autre collègue arrivait de Nice avec la même candeur : – Tu ne te rends pas compte, me dirent-ils, Tricart est tellement mal vu par les géographes de la Sorbonne qu’à l’agrégation, ils éliminent systématiquement ses élèves ; je me souviens de cette phrase : « Vonfelt a été le dernier agrégé strasbourgeois en 1953 ».
Ce séjour dans cette université plus importante que celle de Poitiers m’amena à des découvertes sur l’Enseignement supérieur, ô combien classiques, mais que je n’avais pas encore personnellement acquises. Il y avait des professeurs brillants et sévères comme Jean Tricart et d’autres, surtout en histoire, qui avaient trois étudiants pour l’un et une étudiante pour l’autre, en l’occurrence mon épouse. Chez certains, les cours n’avaient aucune valeur, chez d’autres les faits accumulés et une voix monocorde conduisaient à un inévitable endormissement. Ainsi, un spécialiste très connu de l’Alsace du haut-Moyen Âge était-il surnommé Philippe de Léthargie.
Je ne peux m’empêcher de citer ici Michel Onfray parlant de l’université de Caen dans Le Magnétisme des solstices chez qui j’ai retrouvé mon impression d’alors de l’Enseignement supérieur : « Je m’en ouvris à un professeur qui portait le costume de la modernité dans une université qui ressemblait à une cour des miracles : une momie protestante, un faux-derche, un fainéant, deux ou trois staliniens, un mystique... ».
Les professeurs de Faculté devraient être aussi bons enseignants que chercheurs mais ce n’est pas toujours le cas car ils ne sont jugés que sur leur recherche.
Reçu au CAPES pratique en juin 1961, j’ai été nommé au lycée de Molsheim où j’ai continué à préparer mon mémoire de maîtrise sur Las Hurdes, soutenu en janvier 1963, ce qui m’a permis de m’inscrire cette même année à l’agrégation que je n’eus guère le loisir de préparer. En revenant un jour en fin de matinée de la pêche à la truite, je pris connaissance d’une convocation du Ministère de l’Éducation nationale qui me demandait de venir à Paris et j’ai mis très longtemps à comprendre que c’était une convocation pour l’oral de l’agrégation que je me mis alors à préparer activement.
Je fus reçu, et mon collègue de Nice aussi, ce qui mit fin aux oppositions de la Sorbonne contre la géographie à Strasbourg. Cela me permit de demander le lycée Descartes de Tours car je voulais revenir en Touraine pour que mon épouse se sente moins seule lors de mon service militaire et surtout pour me rapprocher du Collège littéraire universitaire qui venait d’être créé en 1962.
Je fus deux fois inspecté dans ma carrière par mon président de jury d’agrégation, Maurice Crouzet ; la première en décembre 1961 à Molsheim où il écrivit : « il a l’étoffe d’un très bon professeur », et en octobre 1963 au lycée Descartes où j’ai relevé cette phrase dans son rapport : « Jeune professeur très consciencieux et compétent dont les débuts dans l’enseignement secondaire font bien augurer d’une carrière féconde et brillante ».
Enseigner au lycée de Molsheim fut pour moi un grand plaisir ; nous habitions, ma femme et moi ainsi que notre fils bébé, un délicieux prieuré du 15e siècle aux charmants propriétaires. Les élèves étaient studieux et très sages.
Nous en avions beaucoup qui descendaient journellement par le train de la haute vallée de la Bruche ; or, dans les classes de première et de philo, certaines jeunes filles sentaient le schnaps quand je passais dans les rangs ou me penchais sur une copie. Pas d’alcoolisme bien sûr, mais une tradition locale de toilette féminine au schnaps ; c’était une pratique connue dans le Versailles de Louis XIV. Il y avait tellement de vergers sur les collines du piémont et sur les coteaux de la vallée que traditionnellement les fruits étaient transformés en alcool. Quand vous vous promeniez le soir dans les rues désertes de la petite ville, vous remarquiez en octobre-novembre des lumières orange et bleues clignotant à travers les vitres des soupiraux. Les habitants étaient alors en pleine distillation !
Cet extrait de la lettre de Monsieur Hossenlop, principal du lycée de Molsheim, reçue à Tours le 11 octobre 1963, résume mes deux ans de professorat au lycée : « Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour le dévouement à toute épreuve que vous m’avez apporté au lycée de Molsheim. J’ai bien l’impression de vous avoir quelque peu exploité en vous demandant de faire le discours de distribution des prix au moment où vous étiez au plus fort de votre préparation à l’agrégation. Je vous félicite donc doublement : d’abord de votre discours qui était tout à fait dans la ligne de ce que je pouvais souhaiter et qui a eu tous les éloges de votre président, ensuite et surtout d’avoir si brillamment réussi un concours difficile dans des conditions de travail fort pénibles ».
Tout ce dont je me souviens à ce propos, c’est que j’avais dû pour la cérémonie des Prix emprunter la robe d’un professeur chevronné, mais qu’il m’avait fallu épingler le rabat sur le signe brodé des Palmes académiques qu’à cette époque je n’avais évidemment pas. C’est d’ailleurs la seule fois de ma carrière que j’eus à porter une robe de professeur et que je lus le compte-rendu de la cérémonie en allemand parce qu’il n’était pas paru dans l’édition française des Dernières nouvelles d’Alsace.
II. Professeur au lycée Descartes
Après une année au lycée Descartes (1963-1964), je fus nommé professeur à l’École du Génie d’Angers le temps de mon service militaire jusqu’en décembre 1965.
J’en profitais pour assurer des cours de biogéographie à la faculté catholique et des cours de géographie régionale et économique à l’ESSCA (l’École de commerce). Je revins du service militaire à la rentrée de janvier 1965.
J’ai eu, je crois, la réputation d’être dur avec les élèves mais, je l’espère, juste. Un jour de composition, je surpris un élève à tricher avec son livre sur les genoux ; je proférai calmement quelques phrases terribles et l’élève tomba évanoui ; ce ne fut plus d’un seul élève dont j’eus besoin pour qu’il gagne le bureau du proviseur, mais de quatre volontaires pour le porter à l’infirmerie.
Deuxième exemple : un jour de rentrée d’une classe de seconde, sans doute en 1963, je remarque aussitôt deux élèves dissipés sur la droite de la salle, ils étaient en tablier, indication de leur statut d’interne. Celui de gauche dépassa les bornes et je le collai. L’élève s’appelait Sauvé et son voisin s’appelait Villeret. Toute l’année, mes collègues me demandèrent : « Mais tu n’as pas de problèmes toi avec Villeret ? ». C’était un élève très intéressant mais insupportable. J’étais obligé de répondre : « non ! » Vous voyez pourquoi et vous avez sans doute deviné que j’avais eu affaire au futur grand acteur Jacques Villeret qui, en l’occurrence, avait dû dissiper le pauvre Sauvé !
Parler d’acteur me fait penser au metteur en scène Patrice Leconte, qui fut mon élève en classe de Première ; élève intéressant avec lequel nous avions constamment de sympathiques discussions au profit de toute la classe, y compris sur le cinéma. Bien longtemps après, je l’invitai à nous faire une intervention à l’Académie de Touraine où il fit d’ailleurs une remarquable prestation sur son film Ridicule, le tout plein d’humour et sans aucune note. Quand je l’accueillis à l’entrée de la salle de Gaulle du Conseil général et que je lui rappelais l’année scolaire 1963-1964, il me dit simplement : « C’est drôle mais je ne me rappelle pas du tout de vous » ; ce fut une de mes plus grandes surprises et j’ai toujours du mal à concevoir que nos relations privilégiées d’alors n’aient laissé aucune trace dans son esprit alors que moi, je me rappelle le nom de chaque professeur de chacune de mes années de lycée !
III. Dans l’Enseignement supérieur
Le professeur Fénelon me recruta en octobre 1966 comme chargé de cours en géographie au Collège littéraire universitaire de Tours. Mais l’année 1967-1968, la Direction de l’Enseignement Secondaire refusa mon passage comme assistant dans l’enseignement supérieur. Je n’ai pu être nommé qu’en juillet 1968, et d’ailleurs directement comme maître-assistant. J’inscrivis une thèse sur Les vignobles des régions de la Loire moyenne, mais je changeais de sujet au bout de deux ans parce que mes connaissances progressaient en phytogéographie et parce que je ne voulais pas finir avec une cirrhose du foie comme un mien collègue géographe qui avait étudié une grande région viticole française.
1) La mise en place de nouvelles structure universitaires
Profitant de la loi Faure, nous avons passé, à partir de 1969, des milliers d’heures en réunion pour détacher la géographie de la faculté des Lettres et lui donner un statut, sinon de discipline scientifique, du moins d’une discipline de synthèse comportant à la fois des domaines de sciences naturelles et physiques et de sciences humaines, en l’associant pour partie à un Institut d’Aménagement. Ce fut l’UER (Unité d’enseignement et de Recherches remplaçant les anciennes facultés) de Géographie-Aménagement-Informatique.
Le CESA (Centre d’Études supérieures de l’Aménagement) s’était constitué grâce à l’amitié de deux professeurs communistes : le biologiste Vincent Labeyrie et le géographe Yves Babonaux qui allait devenir un de mes amis ; tous deux étaient préoccupés de faire une place à l’écologie et à l’environnement dans les études d’aménagement.
Le Centre d’Études de l’Aménagement me demanda pour la deuxième année de sa mise en service d’y assurer les travaux pratiques d’analyse des eaux. Je dus acquérir toutes les techniques au Laboratoire départemental d’analyse des eaux, ce qui me permit de rencontrer son directeur Jacques Puisais, futur créateur de l’Institut du Goût.
Plus tard, j’eus la chance de pouvoir utiliser le mini-car de l’Aménagement pour faire des sorties de travaux pratiques dans la nature avec huit personnes, y compris avec les étudiants de géographie qu’avec ceux de l’IUT ; je l’ai conduit tant que cela a été possible jusqu’à ce que, pour des raisons budgétaires, il fut condamné des années à rester immobile sous les frondaisons du parc de Grandmont.
2) Polymathe contre universitaire
Faire une thèse sur La biogéographie des Régions de la Loire moyenne et sur l’archéologie de leur paysage nécessitait l’acquisition et la maîtrise de nombreuses disciplines : géographiques (géomorphologie et paléogéomorphologie, méso, micro et paléoclimatologie) et scientifiques (pétrographie (étude des roches), pédologie (étude des sols), botanique, phytogéographie et phytosociologie, zoogéographie, archéologie, ethnographie).
Il fallait en plus disposer de datations de laboratoires et savoir comment les interpréter. En botanique, j’avais en particulier fait un stage avec Claude Dupuis (professeur au Muséum d’histoire naturelle) et Robert Patouillet (botaniste parisien) en juillet 1970, au laboratoire d’été de la ferme du château de Richelieu, propriété de l’université de Paris. En phytogéographie et phytosociologie, j’ai assisté à des sessions extraordinaires de la Société de botanique de France à partir de 1969, et tous les ans de 1969 à 1985, aux colloques ou aux sorties en France ou en Europe, de l’Amicale internationale de phytosociologie dont le responsable était le professeur Jean-Marie Géhu qui vint de nous quitter cette année.
De nombreuses connaissances transversales étaient donc nécessaires alors qu’à l’époque, dans l’université, et chose plus étonnante en géographie alors que c’est une science de synthèse, on privilégiait les connaissances verticales et non les connaissances horizontales. N’oublions pas que si on prend l’exemple des matières médicales et des hôpitaux, on a besoin d’un chirurgien de la main, du genou, etc. spécialités verticales, mais aussi de la médecine hospitalière, spécialité transversale représentée par de rares spécialistes.
C’est une des raisons pour lesquelles en géographie, on a vu se restreindre le champ de la géographie régionale ou de la géographie physique nécessitant sans doute trop d’acquisitions de connaissances et de techniques d’investigation. Beaucoup ont préféré la géographie économique où les sources étaient déjà élaborées, et l’on a vu fleurir des sujets du genre L’industrie du meuble en France ou la géographie de tel ou tel quartier de grande ville. Mieux, certains géographes ont orienté leur carrière uniquement sur les sources de financement disponibles, par exemple sur la ville.
Je me suis trouvé à une époque où en géographie physique surtout, comme en géologie, on poussait encore à des sujets de thèse couvrant des aires par trop étendues ou intégrant des contenus immenses et j’en fus aussi victime.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, avec les incessants conflits que je rencontrai pour l’obtention des postes, que je publiais par fragments les 500 pages déjà rédigées de ma thèse, préférant me consacrer entièrement aux aspects tout à fait nouveaux résultant de mes recherches de terrain en archéologie du paysage et dont je publiais au fur et à mesure l’état d’avancement.
3) Mon laboratoire
Dès 1968, rue Rabelais, Paul Fénelon avait pu monter un petit laboratoire de géographie physique dont je fus amené à m’occuper. Nous avions eu un premier aide de Laboratoire. Ensuite, dans le parc de Grandmont, j’ai monté en 1971 un laboratoire de biogéographie obtenant un grand local et un technicien.
Grâce à l’aide du CNRS et avec la collaboration d’Alain Schulé qui deviendra vice-président de l’université, nous avions acquis beaucoup de matériel pour nos thèses respectives, matériel qui servait à certains travaux pratiques ou dirigés de géographie physique, de biogéographie et d’hydrogéographie.
J’avais installé vingt-trois stations de microclimatologie depuis la forêt de Gâtines jusqu’à Pussigny, et de Chinon jusqu’au Grand-Pressigny, toutes pour mesurer la température et l’humidité au niveau des plantes et du sol. Ainsi avais-je une station au sol à Marmoutier au pied de la falaise et des appareils dans les touffes de Micromeria juliana (seule station française de cette sarriette italienne) sur le balcon du premier étage de la tour des Cloches. Mes mesures dans les sables des bords de l’étang du Vigneau en Brenne ont, par exemple, servi à un spécialiste de l’Institut Pasteur, Claude Pieau, qui étudiait les tortues (Emys orbicularis). Il a pu montrer que le sexe des embryons dépendait des températures d’incubation des œufs par le biais de l’activation ou de l’inhibition de la synthèse d’œstrogènes. Ces mesures m’ont permis de rencontrer des gens divers qui moyennant une certaine somme assuraient les changements de diagrammes hebdomadaires ; je me souviens d’un couple chinonais très pauvre qui vivait dans une masure au sol de terre battue qui me remettait des diagrammes qui sentaient la fumée, car celle-ci envahissait en permanence l’unique pièce à vivre.
J’avais fait un stage d’un mois à Louvain en 1971 pour apprendre les techniques de l’analyse pollinique mais, à la rentrée, le directeur de l’Institut de géographie refusa d’équiper le laboratoire pour lequel je ne demandais que 500 francs (je me suis toujours souvenu du chiffre).
Pendant ma carrière, la géographie physique et ses sous-disciplines n’ont cessé d’être de plus en plus maltraitées et minorées au profit de la géographie humaine, bien entendu au profit de la géologie qui en recueillit des pans entiers.
Ce fut la mode de la géographie urbaine avec l’installation d’URBAMA « Urbanisation du Maghreb ». Ensuite s’installa un important laboratoire de Cartographie qui réalisa L’Atlas de la Région Centre. Notre technicien de laboratoire fut alors détourné pour gagner le Laboratoire de Cartographie.
L’étude de la ville, qui offrait des sources aisées et beaucoup de crédits, fit florès, en particulier avec l’un de mes anciens étudiants qui deviendra plus tard président de l’université : Michel Lussault. On supprima sans raison valable l’espace dévolu au laboratoire de biogéographie pour en faire une salle de cours et bientôt le matériel fut entassé dans une petite pièce et le laboratoire n’eut plus d’existence officielle.
En arrivant dans l’ancienne École normale de filles, nous n’avions jamais eu autant de salles disponibles et pourtant il ne fut plus question de le réinstaller. J’avais gardé accessibles des thermographes et thermo-hydrographes dont des étudiants de mémoire et parfois des étudiants de la faculté des Sciences pouvaient encore se servir.
C’est le jardinier factotum qui m’apprit quel sort fut réservé, au moment de mon départ à la retraite, au matériel du laboratoire qui représentait des dizaines et des dizaines de milliers d’euros : il fut entassé et jeté dans l’escalier d’une cave qui ne servait plus et il n’osa sans doute pas me dire qu’il avait été jeté aux ordures. Seul l’herbier didactique des grandes espèces de la flore du monde que j’avais constitué depuis 1967 mais qui contenait, entre autres planches, celles d’espèces de Suisse et d’Autriche récoltées par le docteur Paul Reclus (le fils du géographe Élisée) entre 1873 et 1877, avait pu être sauvé par un de mes anciens étudiants : Dominique Boutin devenu professeur à l’École du paysage de Blois, et actuellement vice-président de la SEPANT.
Par contre, je n’ai jamais rien su du sort de l’énorme collection pétrographique et paléontologique que j’avais constituée pendant toute ma carrière. Elle avait, sur le campus de Grandmont, rempli six grandes armoires vitrées et n’avait jamais pu être remise en utilisation et exposition en arrivant à Tours- Saint-Symphorien. Elle était donc restée en caisse alors qu’on aurait pu la donner à l’Institut de Géologie, occurrence dont je n’ai jamais entendu parler.
4) Mon enseignement à l’IUT
De 1971 à 1997, j’ai eu un grand plaisir à enseigner à l’IUT en Hygiène de l’Environnement. J’ai pu y maintenir sans problème toutes les sorties nature et écologie nécessaires à mon enseignement.
C’est d’ailleurs avec des étudiants de l’IUT qu’en 1975 nous pénétrâmes dans le massif des hautes landes de Cravant en utilisant des chemins de chasseurs et que nous découvrîmes des cellules de végétation complètement différentes des landes, par exemple des éléments de végétation forestière intacts, soit autour des mardelles, dépressions naturelles liées à un soutirage profond et en eau l’hiver, ce qui m’amena à esquisser une explication de ces phénomènes que j’étudiai plus tard un peu plus en détail, soit parce que l’on tombait sur une unité boisée dont les sols reposaient apparemment sur des lentilles de sables enrichis au lieu des traditionnelles argiles à silex qui devenaient mouilleuses l’hiver (pleines d’eau), et toujours plus ou moins acides.
Après le grand incendie de 1976, je retrouvai la zone de la lentille de sable qu’on avait découverte en 1975, date à laquelle j’avais émis l’hypothèse que ces sables avaient bénéficié de matières organiques en raison d’une présence humaine ancienne. En effet, je découvris que le sol sableux avait été enrichi du fait de l’existence à cet endroit d’une ferme romaine ; à une époque où le climat était frais et humide et où les argiles, trop lourdes, étaient difficiles à cultiver avec les engins agricoles existants. Les sables qui alors chauffaient plus rapidement avaient fixé là une unité culturale ; ils avaient été enrichis par des végétaux brûlés ou consommés par des animaux. Lorsque j’entrepris une série de fouilles systématiques sur les établissements romains d’agriculteurs métallurgistes dans les actuelles landes de Cravant, cette plage de sables fut mon site archéologique n°1.
J’ai eu souvent beaucoup de chance au plan scientifique avec les étudiants de l’IUT. Lors d’une sortie de pétrographie-géomorphologie, nous étions groupés devant un front de taille de carrière aménagé dans une terrasse alluviale d’une vingtaine de mètres d’altitude relative au-dessus de la Vienne à Séligny, commune d’Antogny-le-Tillac (37). Je leur apprenais comment reconnaître les trois niveaux de terrasses fluviatiles existant dans nos régions et tous trois déposés pendant les phases froides, puis dégagés ensuite : soit grâce à l’altitude relative au-dessus du plancher actuel de la vallée, ce qui ne suffisait pas, soit par l’étude du matériau alluvial : contrairement au matériel granitique du Würm (le niveau inférieur correspondant à la dernière glaciation : de - 120 000 à - 10 000 ans) venu de l’amont de la Vienne (du Massif Central), peu décomposé parce que déposé dans la période froide qui avait succédé à la dernière phase de climat tropical. Ici, on avait une couleur dominante orange foncé indiquant que les feldspaths et les micas avaient été hydrolysés en argile ferriques ou ferreuses en période chaude et humide. C’était le signe d’un dépôt effectué pendant une phase périglaciaire plus ancienne : celle du Riss (de – 325 000 à – 130 000 ans). Ce dépôt avait donc connu après coup une phase tropicale dans l’intervalle entre le Riss et la dernière phase périglaciaire du Würm, c’est-à-dire pendant l’interglaciaire Riss-Würm.
Je dis ensuite aux étudiants qu’il existait un autre moyen de datation encore plus sûr : le matériel préhistorique roulé dans les alluvions mais qu’on en trouvait rarement ; sur ces paroles, je me tourne vers le front de taille et je dis : « d’ailleurs voilà un biface », ce qui était d’un culot monstre car on ne voyait que l’arrondi de la partie arrière. J’ai d’ailleurs eu beaucoup de mal pour sortir l’objet (plusieurs dizaines de secondes avant de savoir si je n’avais pas galéjé). C’était un magnifique petit biface que j’extrayai avec difficulté ; ainsi les étudiants purent-ils voir que je n’étais pas venu la veille le mettre en place ! Et je terminai en déclarant voilà un superbe petit biface moustérien de tradition acheuléenne donc de plus de 100 000 ans confirmant l’âge Riss du dépôt. Biface que je publiai d’ailleurs dans le Bulletin des Amis du musée du Grand-Pressigny.
5) Mon enseignement en géographie
Enseigner et à tous les niveaux, fut pour moi une très grande joie. D’abord à l’Institut de géographie où nous avons obtenu en 1990, un DESS (Diplôme d’études supérieures spécialisées) « Paysage », l’ancêtre des masters actuels, dont je fus le premier directeur. Au total, j’ai enseigné pendant toute ma carrière dans onze établissements universitaires différents, sans compter des interventions ponctuelles comme à l’école d’architecture de Nantes, ou en DEA de biogéographie à l’université de Paris VII. Par exemple, en géographie en FLE (Français Langues Étrangères) à la Faculté des Lettres de 1990 à 1997, en sciences et biogéographie pour la Cellule de formation des Maîtres de Tours en 1987 et 1988, dans les centre régionaux de formation des Maîtres dans les anciennes écoles normales de Fondettes (37) et de Châteauroux, à la faculté de Sciences de Tours et à Chinon en IMACOF, c’est-à-dire à l’Institut de Maîtrise appliquée des Corridors fluviaux etc.
Mes sorties comme mes cours étaient détendus ; deux fois seulement j’ai assisté à un spectacle qui m’a moi-même beaucoup marqué et qui n’a pas laissé les étudiants indifférents. Après avoir fait rire l’amphi à cœur joie, au point que certaines jeunes filles avaient bien du mal à se contrôler – je revois les garçons tapant sur leur tables, morts de rire– ce qui arrivait parfois– les paroles qui me vinrent ensuite furent curieusement les plus aptes à faire enfler le rire comme si un être particulièrement doué avait parlé à ma place, la salle connut un rire inextinguible d’environ trois minutes qui nous laissa tous, moi le premier, épuisés d’avoir autant ri.
Pour des raisons de restrictions financières, j’ai eu, en géographie, beaucoup de mal dans les dernières années à maintenir les sorties dans la nature qui m’ont toujours paru indispensables pour illustrer mes cours. Comment initier à l’étude des sols, à la pédologie, sans être devant des coupes de sols, à la botanique et à la phytogéographie, sans être au milieu des plantes sauvages ?
IV. Mes recherches
A. Quelques découvertes biogéographiques isolées
1) Un hybride d’alose inconnu
On connaît en France trois espèces d’alose : la grande (Alosa alosa) présente en particulier sur la Loire et la Vienne, et qui a des qualités culinaires appréciées ; l’alose feinte (Paralosa fallax) peu considérée au plan culinaire, dans les mêmes eaux, et l’alose du Rhône (Alosa fallax rhodanensis). Or, j’avais coutume d’aller à la pêche à l’alose avec mon grand père depuis 1950 environ, à Marcilly-sur-Vienne, où nous pêchions l’alose feinte, la grande alose ne mordant pratiquement pas à la ligne.
Cette pêche était néanmoins intéressante car l’animal que nous voyions sauter partout en période de frai, se défendait farouchement une fois accroché. Cette alose feinte, nommée localement « coverau », est reconnaissable à ses six à huit taches post operculaires bien marquées, contrairement aux trois ou quatre grosses taches de la grande alose. Or, à partir de 1964, il m’est arrivé de pêcher, parfois en série, des sujets plus gros que l’alose feinte, de 900 g à 1200 g, ayant des reflets roussâtres, avec quatre à cinq taches post-operculaires marquées et dont la chair était plus délicate que celle de l’alose feinte. Pour moi, très tôt, j’ai pensé à un hybride entre la grande alose et la feinte d’autant que les pêcheurs au filet-barrage de la Loire avaient jadis remarqué cette variété qu’ils appelaient « bouvard ». Un seul ichtyologue l’avait évoquée sans d’ailleurs parler d’hybride : de La Blanchère, en 1868, dans son ouvrage La pêche et les poissons. Je communiquai cette découverte au Congrès national des Sociétés savantes de Tours en 1968 et le texte fut publié dans les Actes en 1970. Le problème a intéressé Madame Catherine Mennesson-Boisneau, chercheur en hydrobiologie, qui, dans sa thèse soutenue en 1981 et publiée en 1990, a montré que les recherches génétiques prouvaient l’existence d’un hybride. On ne risque d’ailleurs plus de le retrouver car il était lié au barrage du Bec des Eaux détruit depuis 1998. Jadis, au pied du barrage, les grandes aloses arrivaient en avril, alors que les aloses feintes arrivaient en juin, voire en juillet ; mais souvent les premières ne pouvaient passer le barrage, les eaux étant trop grosses, et elles étaient donc condamner à frayer et à pondre en même temps que les feintes au pied du barrage d’où une hybridation non naturelle.
2) Une tourbière à « tremblants »
Grâce à un ami professeur de sciences naturelles, j’appris un jour une chose étonnante, qu’il y avait dans une forêt privée, à Saint-Roch, donc non loin de Tours, une tourbière avec des tremblants ! Il s’agit de radeaux de mousses (essentiellement des Sphaignes) colonisant la périphérie et parfois la totalité des eaux acides d’un étang ou d’un petit lac ; situation qu’on ne rencontre en général que dans des régions aux roches et aux sols très acides comme dans le massif Central et/ou en altitude.
Nous l’étudiâmes en marchant sur des rideaux de mousses de 35 à 45 cm d’épaisseur, au-dessus de plusieurs mètres d’eau ! Ceci me permit de trouver Eriophorum gracile, une espèce de linaigrette qui n’avait été signalée qu’une fois en Touraine et qui avait disparu, et des espèces de sphaignes nouvelles pour le Centre-Ouest de la France.
J’avais intéressé une palynologue au problème et publié en équipe une synthèse sur la formation de la cuvette, la naissance de la tourbière et sa richesse floristique.
3) Des buttes tourbeuses en forme de petits tumulus
L’exemple précédent montre que des eaux acides peuvent créer au cours du temps des tourbières à sphaignes dites « hautes » parce que l’exondation des mousses se fait au centre des tourbières acides, partie la plus acide, pouvant atteindre trois ou quatre mètres de hauteur. Quelle ne fut pas ma stupeur en me rendant à la ferme de la Ronce à Beaumont-la-Ronce chez un fermier où un collègue croyait avoir vu un tumulus, de découvrir qu’on avait en fait là un type de tourbière totalement inconnu installé sur des sources de nappes captives à conduit vertical, mais des tourbières qui loin d’être acides étaient très basiques car elles colonisaient des eaux très calcaires venant des profondeurs à travers des limons calcaires appartenant aux calcaires lacustres tertiaires. On pouvait enfoncer au centre de la butte de mousses un jeune arbre mort de six à sept mètres de long et qui ne demandait qu’à nous échapper en filant en profondeur ! Or, parcourant seul les marais de Montifray, sur la même commune, je trouvai de nouvelles tourbières de ce genre à Hypnacées (familles de mousses colonisant les milieux basiques), y compris au sud de la commune de Saint-Paterne-Racan, au sein des marais.
Je fis part de cette découverte lors d’une réunion au Conseil de l’Europe à Strasbourg devant mes collègues de l’Amicale européenne de Phytosociologie et là, un collègue belge, Jean Duvignaud, déclara avoir vu un unique exemple semblable sur les calcaires primaires de l’Ardenne.
B. Mes fouilles
À Cravant (37), je trouvai vingt-trois sites romains sur le plateau des landes ; j’en fouillai trois intégralement, j’en sondai deux et je fis des ramassages de matériel sur les autres, ce que je n’aurai pu faire si la lande n’avait pas disparu lors d’un grand incendie.
Je fouillai deux autres sites en 89-90 en forêt de Crémille à Mazières (37) : des buttes de matériel correspondant à des ruines d’ateliers médiévaux. C’était non loin du château, en propriété privée. Enfin, en forêt de Chinon, au-dessus de l’abbaye de Turpenay, nous avons désencombré un puits médiéval pendant trois ans (1991-1993) sur douze mètres de profondeur et retrouvé la margelle du XIIe siècle qui y avait été jetée. Nous avons été aidés dans cette dernière opération par le club spéléo de l’université. Lors de cette fouille, nous avons eu d’excellents contacts avec la population locale, en particulier avec Monsieur et Madame Dioclès de Rivarennes, un couple charmant qui pratiquait encore la production de la poire tapée pour apprendre à un groupe d’amateurs du village des techniques anciennes qui risquaient de se perdre.
Nous avons eu aussi d’excellents contacts avec les jeunes fouilleurs, soit avec des élèves du lycée de Chinon pour les fouilles de Cravant, soit avec certains de mes étudiants pour les fouilles de Mazières. Avec eux nous faisions du billard japonais après nos repas à Cinq-Mars-la-Pile. L’un d’eux est devenu le Directeur de la Maison de la Loire, un autre, ces années-là, détint le record de lenteur de la traversée de Tours : 11 ou 12 heures si je me rappelle bien. En effet, venu du Nord après avoir un peu trop célébré Bacchus, un soir tard, il avait arrêté sa voiture sous un platane de l’avenue de Grammont pour mieux récupérer et n’était reparti que dans une matinée déjà avancée.
C. Mes recherches en archéologie du paysage
Après l’étude des landes de Cravant et de Sologne qui me permirent de rédiger une note à l’Académie des sciences sur la phytocinétique des landes, je pus montrer que toutes nos grandes landes du Centre-ouest de la France avaient été des forêts bien portantes au début de l’Antiquité.
Mais elles avaient été décimées soit par le feu pour l’agriculture, soit par des coupes répétitives de jeunes bois, pour les fours des métallurgistes jusqu’au deuxième siècle de notre ère. Dégradation qui s’est poursuivie par les feux allumés par les bergers au cours du Moyen Âge. Sur des sols acides et mouilleux (pleins d’eau l’hiver), ces coupes sans cesse répétées avaient installé une lande dense et acide qui a fini, en raison de l’épaisseur de l’humus, par interdire aux arbres de repousser. Ce n’était donc pas une lande originelle comme sur les crêtes granitiques ou les côtes rocheuses de Bretagne.
Parmi les preuves, les analyses polliniques et mes découvertes progressives d’un total de plus de 1400 ha de « celtic fields ». Il s’agit de structures agraires de petits champs bordés de talus, de murets ou de fossés, d’un âge allant de l’âge du Bronze à la période romaine. Ici il s’agissait de champs faiblement rectangulaires bordés de talus et d’âge protohistorique. Grâce à des levés à la lunette et des coupes au tractopelle, je retrouvais le plan des champs, la structure des talus et même les sillons chargés de charbon de bois car la culture s’y était faite avec étrépage, c’est-à-dire en brûlant des végétaux coupés dans la lande voisine et épandus sur le sol à cultiver. Je découvris ces structures jusqu’alors inconnues en région Centre, d’abord dans les landes de Cravant et la forêt de Chinon, puis dans les landes de Saint-Martin au nord de Bourgueil, et enfin en forêt de Moulière(86) et en Brenne (36).
D’une façon générale, les paysages peuvent évoluer plus ou moins rapidement par le triple jeu contradictoire de la progression végétale naturelle et de régressions ou de substitutions liées à l’homme, et le biogéographe doit apprécier leur statut grâce à leur signature dynamique d’ensemble faite de la dynamique de l’occupation de chaque compartiment du terrain. L’action de l’homme passe par plusieurs niveaux : l’exploitation, simple prélèvement d’un produit sur l’écosystème (exploitation forestière ou touristique par exemple), la mise en valeur, qui améliore la qualité du produit (création d’équipements touristiques par exemple) et l’aménagement qui doit prendre en compte les effets à long terme d’une intervention et exige des bilans en termes de biomasse et de coût. Opération qui, par exemple, n’a jamais été faite en Ouzbékistan lors de l’aménagement des rives du Syr Daria et de l’Amou Daria au service d’une monoculture cotonnière très dépensière en eau, d’où l’assèchement de la mer d’Aral !
IV. Mes implications dans les domaines associatifs ou techniques
1) J’ai été cinq ou six fois président de la SEPANT (Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature en Touraine), association née au sein du Laboratoire d’écologie de la faculté des Sciences en 1969 lorsqu’il s’est agi de défendre les glaciers du massif de la Vanoise et le parc national du même nom contre les empiétements grandissants des stations de ski.
Je me suis fortement impliqué contre le passage de la future autoroute Angers-Tours en domaine forestier, puis contre son passage en Val de Loire. Notre plan était une voie expresse parallèle à la route Tours - Château-la-Vallière et ensuite à la route toute droite Noyant-Baugé-Angers. J’ai organisé une pétition nationale, réalisé une émission télévisée avec Antoine Reille dans le cadre des Animaux du Monde et organisé une manifestation à Tours en 1979 avec 1500 personnes et une vingtaine de maires en tête du cortège.
Sans doute à ce titre, parce que nous menions une campagne importante contre un tracé autoroutier qui devait passer en pleine forêt, j’ai eu le sentiment (à partir de quelques indices) d’être sur écoute téléphonique. Je téléphone un jour à ma vieille grand-tante de Lyon qui me donne de ses nouvelles, et comme il était de règle, une liste très détaillée et très longue des affections dont elle souffrait… Un léger silence, et j’entends une voix masculine ajouter, non pas sur le mode interrogatif, mais en addition à l’énumération précédente, « Et la transpiration des pieds ! » et ma tante de répondre : « Hein ? Qu’est-ce que tu dis ? ». À partir d’un certain moment que je ne saurais dater, tous les indices antérieurement remarqués disparurent.
Nous avons gagné pour la défense de la forêt mais le tracé définitif a emprunté le Val de Loire.
Bien entendu, il y a eu d’autres combats mais aussi beaucoup d’échecs car la population n’était pas du tout ouverte à l’écologie, et elle ne l’est d’ailleurs toujours pas sur les dangers du nucléaire, des pesticides ou des pollutions atmosphériques par exemple.
Nous avions obtenu par contrat dûment signé entre la SEPANT et le Groupement forestier de Cravant-Saint-Benoît la gestion et la préservation de dix ha de lande du petit Éplin où la plus grande partie de la surface était occupée par des mardelles (petites mares naturelles) en eau l’hiver, territoire le plus intéressant pour la flore et l’ornithologie, de toutes les landes de Cravant. Mais avec duplicité, on nous avait remis la gestion de cet espace après l’avoir semé de pins maritime et ce, sans nous avoir prévenus. Bientôt nous avons vu pousser de jeunes pins que nous avons coupés peu à peu pour ne pas qu’ils fassent mourir la lande, mais il y en avait beaucoup ! Bientôt les chasseurs feignant de n’être point au courant disaient : « Comment ! les écolos coupent nos pins ! C’est inadmissible! ». Et, lors d’une mémorable (et un peu houleuse) réunion à Cravant, nous avons dû aller à Canossa devant le président du groupement forestier : André-Georges Voisin, président du Conseil général, malgré les contrats en bonne et due forme qu’il avait lui-même signés.
J’ai, dans le cadre de cette association, organisé beaucoup de sorties nature en Touraine, en France et en Europe. La SEPANT est toujours une société active.
2) Après un voyage en Slovaquie et en Hongrie en 1989, j’ai, au retour, fait une conférence sur la Hongrie à la Société de Géographie où j’ai rencontré Judith de Gérando-Charpentier, une personne d’origine hongroise, qui voulait créer une association « Amitiés Touraine-Hongrie ». Cela se fit et j’ai été son vice-président pendant dix ans ; j’ai appris le hongrois avec mon épouse qui est l’actuelle présidente de cette association.
Nous avons contribué à organiser un pacte d’amitié entre Szombathely, la ville de naissance de saint Martin, et Tours. Nous organisons des voyages en Hongrie tous les deux ans et le dernier remonte à mai dernier où nous apporté au maire de Szombathely une lettre du maire de Tours.
3) Un de mes collègues phytosociologues de Lille avec qui j’ai herborisé dans plusieurs pays d’Europe avait créé une association écologique, l’AMBE (Association multidisciplinaire des biologistes de l’environnement) et il m’a demandé, dans les années 80, de participer à des études de réaménagement paysager, d’équipement de lignes électriques pour la protection des oiseaux, d’études de géographie botanique et de paysages. Je suis peu à peu devenu son correspondant pour l’ensemble de la région Centre. J’ai ainsi participé à l’aménagement paysager des trois stations de pompage et de stockage gazier de Soings-en-Sologne, Chémery et Céré-la-Ronde. De même pour la mise en place des équipements répulsifs anti-oiseaux sur nombre de lignes à haute tension dans le Cher et l’Indre en particulier.
4) Sur le plan de la défense de la flore et de la faune, je me suis beaucoup investi. Par exemple dans la définition des plantes à protéger régionalement ; il me souvient qu’avec mon collègue botaniste Philippe Maubert de Blois, nous sommes allés, un certain jour, défendre au ministère de l’Environnement la liste des espèces végétales protégées qu’on avait longuement dressée au cours de réunions à Orléans. L’arrêté sur les plantes protégées en Région Centre date du 12 mai 1993 et curieusement, cette liste parut au journal officiel le 14 juillet 1993.
Je suis resté membre, à la suite de plusieurs mandats successifs, du CSRPN, c’est à dire du Conseil supérieur régional de Protection de la Nature, chargé de déterminer toutes les protections faune-flore de la Région, de statuer sur les propositions de réserves naturelles, de zones protégées, etc.
5) À partir de 1994, des ingénieurs de l’INAO (Institut national des Appellations contrôlées) m’ont demandé si je voulais devenir expert tant pour les appellations fromagères – j’ai été un des quatre experts qui ont donné une appellation d’origine au fromage de Valençay– que pour les appellations viticoles. Actuellement nous travaillons sur les sous-appellations « Touraine-Oisly » et « Touraine-Chenonceaux » de l’appellation « Touraine ».
6) À partir de 1997, je me suis investi dans l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine ; j’ai d’abord été secrétaire-adjoint, puis secrétaire. J’ai, en 2001, remplacé le professeur Émile Aron à la présidence. Cet homme de grande classe, au langage mesuré, ouvert sur le monde, aimait converser. Combien de fois, les jours de réunion du conseil de l’Académie, après l’avoir raccompagné à son domicile, sommes-nous restés à discuter dans mon véhicule garé devant son garage… J’avais le sentiment d’être presque toujours d’accord avec ses pensées, ce qui est le cas quand on devise avec de grands personnages qui ont une appréhension mesurée du monde. Je repensais alors à ce qu’avait écrit Ramon Fernandez dans son in memoriam de Jacques Rivière : « Sa conscience était comme une banque spirituelle où vous aviez déposé votre médiocre capital dont il triplait les revenus avec discrétion et fidélité en dissimulant son bienfait sous des monceaux d’excuses. » Citation parfaitement valable, les excuses en moins.
Bien entendu, l’Académie très bien aidée par la Société des Amis de l’Académie de Touraine, déploie une importante activité avec des concerts, des voyages, des expositions, une séance décentralisée tous les ans en juin en périphérie du département d’Indre-et-Loire, l’organisation de rencontres annuelles que j’ai mises sur pied en 2008 entre les quatre académies de la Région Centre – la prochaine sera dans un mois le 20 septembre à 9 heures où vous êtes cordialement invités à l’hôtel Mercure-Nord situé près des casernes du camp d’aviation (entrée gratuite) – le thème de cette rencontre étant Les scientifiques de la Région Centre. D’ailleurs nous participons actuellement (une équipe de huit personnes) à la rédaction du Dictionnaire des Scientifiques de Touraine qui sera publié en 2015 aux Presses de l’université de Tours.
Enfin, j’ai pu faire entrer, il y a cinq ans, l’Académie de Touraine au sein de la Conférence nationale des Académies de Sciences, Lettres et Arts. Celle-ci regroupe les très anciennes Académies des provinces françaises, disposant d’une activité scientifique et de publications reconnues ainsi que de statuts comparables à ceux des Académies nationales.
Conclusion
Mon départ en retraite s’est fait en 1997 à la fois pour mes enseignements en hygiène de l’Environnement à l’IUT et à l’Institut de géographie. Bien entendu, j’ai alors abandonné certaines fonctions comme la direction régionale de la revue géographique Norois et ma participation au Groupe d’Histoire des Forêts dont le siège est à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Mais j’ai pu, conformément à la loi, devenir pendant cinq ans chargé de cours sur les Paysages à la faculté des Sciences d’Angers.
Le lundi 3 février 2014, j’ai été interviewé en public par la Commission patrimoine de l’université de Tours qui enquête sur les carrières d’anciens enseignants ou de responsables de l’université en vue de préparer une histoire de l’université de Tours. J’ai eu l’occasion de dénoncer certains travers et certaines insuffisances sans avoir toutefois l’illusion que cela puisse contribuer à y porter remède. Les vaccins de l’élucidation prémunissent-ils contre les poisons de l’éternel retour ?
J’ai à ce moment là, retrouvé par hasard et donc lu pour la seconde fois ce qu’avait écrit le doyen de la Faculté d’Aménagement-Géographie-Informatique lorsque je fus élevé au grade d’officier dans l’ordre des palmes académiques en décembre 1988 [J’étais chevalier depuis octobre 1983] : « Monsieur Jean-Mary Couderc est un enseignant de caractère, passionné par son métier et fidèle à ses idées… Il sait faire partager à ses étudiants son goût pour sa discipline et sa spécialité d’archéologie du paysage... c’est un homme dont le rayonnement excède largement l’université et qui mérite par son influence, son courage que certains peuvent parfois considérer comme de l’intransigeance, la promotion au grade d’officier dans l’ordre des Palmes académiques ».
Jean-Mary Couderc
|
|