Alain-Fournier et la Touraine
par Isabelle Papieau
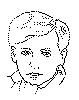
9èmes RENCONTRES LITTÉRAIRES
DANS LE JARDIN DES PRÉBENDES, À TOURS
Vendredi 3 août 2007, de 17 h 30 à 19 h
|
Alain-Fournier et la Touraine par Isabelle Papieau |
|
Lire la présentation de cette « rencontre ».
Lire la biographie d’Isabelle Papieau par Catherine Réault-Crosnier.
|
Je suis vraiment flattée d’être reçue à Tours et honorée d’intervenir dans ce très esthétique jardin des Prébendes que n’a malheureusement pas connu Alain-Fournier, lors de sa participation aux grandes manœuvres, en 1908 : des grandes manœuvres qui ne lui ont pas permis de découvrir les richesses du patrimoine tourangeau mais l’ont fait circuler dans différentes communes de Touraine, de la Vallée du Cher et lui ont dicté quelques jolies pages de ses correspondances. L’objet de mon intervention sera précisément le séjour en Touraine de notre cher auteur du Grand Meaulnes : un roman mythique et intemporel qui a marqué des générations d’adolescents. |
|
D’Épineuil au service militaire.
Quelle a été précisément l’histoire de vie d’Alain-Fournier lors de son immersion en Touraine, dans le cadre des fameuses grandes manœuvres ?
Alain-Fournier (alias Henri-Alban Fournier) est né en 1886, à La Chapelle d’Angillon : une petite commune située à une vingtaine de kilomètres au nord de Bourges. Nous savons que la première partie de son roman Le Grand Meaulnes est le miroir d’une enfance heureuse : celle que vit Henri à Épineuil-le-Fleuriel où ses parents sont instituteurs de 1891 à 1898 (année au cours de laquelle il est reçu premier du canton au certificat d’études). Il devient en 1900, pensionnaire au lycée Voltaire, à Paris, établissement qu’il quitte en 1901, pour rejoindre -fasciné par la marine- le lycée de Brest. Le jeune Henri mettra cependant, un terme à sa préparation d’études navales sur le navire-école « Le Borda » et intégrera la classe de rhétorique du lycée de Bourges.
Il est élève au lycée Lakanal de Sceaux -en 1903- lorsqu’il rencontre, à 17 ans, celui qui deviendra à la fois, son ami fidèle, son confident et son beau-frère : Jacques Rivière...
Le 1er juin 1905, au cours de l’après-midi de l’Ascension, Alain-Fournier vient de visiter le Salon de la Nationale, au Petit-Palais. En descendant l’escalier, il croise le regard d’une élégante jeune fille blonde, vêtue d’un grand manteau marron. Il la suit sur le Cours-la-Reine, le bateau-mouche, puis, jusqu’au porche d’un immeuble boulevard Saint-Germain, où elle pénètre. Le 11 juin, jour de la Pentecôte, Henri arbore son uniforme du lycée Lakanal (où il est en rhétorique supérieure). « Je ne veux pas lui mentir », avoue-t-il ; « elle doit savoir que je ne suis encore qu’un collégien ». Il est là, très tôt le matin, boulevard Saint-Germain et voit la jeune fille sortir seule de l’immeuble, tenant un livre de prières. Avant qu’elle ne monte dans le tramway, Henri se hasarde à lui murmurer : « Vous êtes belle ! », comme dans Pelléas et Mélisande de Debussy : un opéra qui séduira Alain-Fournier au point d’aiguiser sa grande sensibilité pour le symbolisme. Il suit la jeune fille élancée, « hautaine et noble » jusqu’à l’église de Saint-Germain-des-Prés et l’accoste de nouveau, à la fin de la messe. Assimilée -dans l’imaginaire d’Henri- à « une demoiselle sous une ombrelle blanche qui ouvre la grille d’un château, par quelque lourd après-midi de campagne »(1), la jeune fille échange avec notre lycéen jusqu’au pont des Invalides où ils se séparent. « Nous sommes des enfants, nous avons fait une folie », rétorque-t-elle. « Si grande était sa candeur et notre hauteur », écrira Alain-Fournier dans une lettre au petit B., « qu’on ne savait de quelle folie elle voulait parler, il n’y avait pas encore eu de prononcé un mot d’amour ». En ce dimanche de Pentecôte, la jeune fille annonce à Henri qu’elle va retrouver ses parents à Toulon.
Du 3 juillet au 7 septembre 1905, le jeune Henri part pour l’Angleterre (dans la banlieue ouest de Londres) où il travaillera comme secrétaire, avant son examen de licence d’anglais. Il écrira de Londres à Jacques Rivière : « Je regrette de n’être pas enseigne sur ce bateau, de ne pas vivre une vie en uniforme noir, autoritaire et rude à travers la mer, pour aller un jour demander à Toulon, la main d’une hautaine jeune fille blonde, dont le père a traversé cinq fois l’Océan »(2).
À l’Ascension 1906, un an après la rencontre, Henri Fournier va guetter vainement la jeune fille sur le Cours-la-Reine. La même année, Henri échouera au concours d’entrée à l’École Normale et il apprendra en 1907 (au terme d’une ultime année de « khagne » à Louis-le-Grand), le mariage de cette insaisissable jeune femme (qui deviendra, dans Le Grand Meaulnes, Yvonne de Galais) avec un médecin de la Marine.
Entre 1908 et 1909, Henri Fournier fait son service militaire. Il va connaître une incorporation déprimante au 23ème « Dragons », à Vincennes. Lors d’une visite à la caserne, sa sœur Isabelle dresse de son frère, un portrait dramatique : « Vêtu d’un bourgeron informe, malpropre, noirci de boue et de cirage, une lanière bleue autour du cou, les cheveux ras, les mains gourdes, sales, écorchées -ses belles fines mains blanches !- les yeux rougis, le visage gonflé de fatigue, l’air si lointain et accablé qu’il ne peut même pas sourire, il nous regarde avec une espèce de stupéfaction, comme s’il n’arrivait pas à se rappeler qui nous sommes, ou comme s’il nous pensait tombées d’un autre monde. J’ai la sensation que c’est un forçat que nous sommes venues visiter, enseveli pour des siècles dans ce malheur, dans cette condamnation »(3).
Il sera muté au 104ème d’infanterie, à la caserne de Latour-Maubourg, dont il exècre le peu de luminosité mais qui le rapproche de sa famille et lui permet des sorties, le soir. Puis, ce sont les manœuvres à Maisons-Laffitte, suivies d’une marche éreintante vers le camp de Mailly. Enfin, se dérouleront en septembre 1908, les grandes manœuvres du Centre. C’est dans ce contexte très particulier (émaillé, qui plus est, par son échec à la licence d’anglais et le récent mariage de sa sœur avec son meilleur ami, Jacques Rivière) qu’Henri Fournier va découvrir la Touraine.
Le fantassin Fournier et les grandes manœuvres du Centre
Lorsque le fantassin, Henri Fournier, commence les grandes manœuvres, il est caporal et vient d’apprendre (la veille, précisément) son succès à l’examen des élèves-officiers. Ces grandes manœuvres du Centre auront, cette année-là, un caractère exceptionnel. Elles se singulariseront, en effet, par un effectif de 125 000 hommes (un nombre dépassant celui des manœuvres impériales mises en place autour de Metz) et par leurs objectifs : étudier la potentialité de la création d’un corps de téléphonistes militaires, le recours fonctionnel et stratégique à un corps de cyclistes combattants et l’intérêt de la constitution d’un corps de fantassins cyclistes. Ces grandes manœuvres seront aussi l’occasion de tester des cuisines roulantes conçues de façon globalement similaires à celles dont bénéficiait l’armée russe.
Après un jour de repos (le 8 septembre), le jeune Henri va manœuvrer au-dessous de la ligne « Contres, Montrichard, Bléré, Tours », dans une Touraine au vignoble ruiné : les gelées blanches d’avril ont endommagé les cépages blancs et le « mildiou de la grappe » a ravagé les cépages rouge ; une « horde sauvage de chardons » s’est même emparé des pampres de feuilles(4). Après des marches de concentration, le caporal Fournier participera pendant quatre jours, aux manœuvres de corps d’armée contre corps d’armée : des exercices qui le conduiront entre Cormery et Chitenay, près de Pontleroy, dans un hameau de l’autre côté d’Angé. Le soir du 11 septembre, l’ensemble des troupes ayant participé aux manœuvres de corps d’armées composèrent deux armées pour les besoins de la deuxième période de manœuvres. Organisée du 13 au 18 septembre et centrée sur des opérations conduites comme en temps de guerre, cette dernière période devait faire s’affronter l’armée A ou rouge (sous les ordres du général Trémeau) et l’armée B ou bleue (sous les ordres du général Millet). Dès le 13 septembre, à cinq heures du matin, Henri Fournier dut s’adonner aux hostilités : des hostilités suspendues quotidiennement de midi à dix-neuf heures (heure à laquelle devaient être pris les avant-postes). Les conditions météorologiques s’avèrent pénibles : les journées sont brûlantes, les nuits glaciales. Le soldat Fournier est loin des doux et nostalgiques souvenirs de chasse de Nançay où il passait toujours depuis dix-huit ans, quinze jours à la fin de l’été : des « chasses dans les sapins », des « journées entières dans les brandes » solognotes, des « coups de fusils sans interruption » qui faisaient sentir la poudre partout(5) mais contribuaient à métamorphoser ce lieu de vacances en un antre du rêve et de petits bonheurs familiaux, réactivant chez le jeune homme, toute « la poésie immense » de sa « vie là-bas »(6).
Lors de ces grandes manœuvres, de nombreuses opérations de nuit obligent les détachements à coucher en plein air et bivouaquer sur le terrain. Ainsi, Henri vécut deux nuits de bivouac dont il dépeint toute la pénibilité dans ses correspondances : « Dimanche soir, première nuit au bivouac. Nous faisons de vagues abris en paille, sous lesquels on s’entasse et se serre. Sans presque de paille, tout équipés, la fatigue nous endort par terre. Le froid terrible gagne ; recroquevillés, détendus, bientôt ankylosés de partout, nous tombons dans un sommeil-cauchemar, un bras gourd sous la tête en guise d’oreiller. Pas plus d’une heure ou deux je reste ainsi terrassé, puis, tout empêtré dans l’équipement, je me glisse dehors au froid clair de lune. Les cuisiniers ont allumé de grands feux pour faire réchauffer le café, je m’en approche trébuchant et frissonnant »(7).
Les souvenirs édulcorés des vacances en septembre à Nançay et de la bonne odeur du café qu’on torréfiait dans la cour de la boutique de l’oncle Florent, apparaissent sans doute au jeune homme, bien lointains. « Il est minuit et demi », raconte-t-il à son père, « et jusqu’à une heure, l’heure du départ, un à un, se glissent autour du feu tous les hommes de la compagnie, chacun racontant en claquant des dents la même misère que le précédent. La nuit suivante, même programme »(8).
Le 18 septembre et après que l’armée A eut pris la position de Luçay-le-Mâle, l’armée B dut se mettre en retraite. Un avis du ministre de la guerre étant arrivé dans la nuit, l’action cessa avant huit heures. Il n’y eut pas de revue finale au grand désespoir d’une foule venue nombreuse : elle put cependant, assister à une dernière manœuvre dite « théâtrale » : on brûla, rapporte le journal La Touraine Républicaine, « de la poudre aux moineaux pendant près de deux heures ; l’artillerie et l’infanterie firent un feu d’enfer »(9). Lors de la dislocation du 19 (commencée dès quatre heures du matin), Henri Fournier embarqua à Saint-Martin-le-Beau.
Malgré la rudesse de la tâche (inconfort des bivouacs, fatigue causée par de longues marches forcées...) et la misère morale qui, note Alain-Fournier, « était grande dans les rangs »(10), les effectifs vont terminer ces manœuvres presque au complet : les médecins, confirme la presse, n’auront eu à soigner que quelques entorses. Henri fera preuve de cette persévérance qui explique une moyenne des indisponibles -dans l’effectif total- limitée à 6%.
Le 15 septembre, relate le jeune Fournier à son père, « nous avons dû faire près de cinquante kilomètres. La manœuvre a fini à midi, mais on a dû marcher ensuite jusqu’à neuf heures du soir. Il a fallu des voitures de paysans pour ceux qui ne pouvaient plus marcher. Je n’étais pas fatigué autant que déprimé par les marches, les insomnies et les privations précédentes. Je suis un des rares qui ont voulu garder leur sac jusqu’au bout, non par bravade mais parce que, arrivé à cet état de dépression, je savais que rien, sinon le sommeil, ne pouvait me soulager. Je suis arrivé les genoux raides, mais les pieds comme des miroirs, et frais encore »(11).
Quelle perception Henri Fournier a-t-il de la Touraine ?
Quelle place le jeune Henri -qui venait, durant l’été, de consacrer des heures dites « délicieuses » à l’écriture du Grand Meaulnes et trouvait cependant terriblement dur d’avoir à écrire au régiment- accorde-t-il au décryptage du paysage de Touraine et à son traitement littéraire ?
Les descriptions que nous a léguées Alain-Fournier à travers ses correspondances témoignent de son goût affiné pour la poésie réaliste, sensuelle et claudélienne que lui ont suggéré les terres de cette Touraine « ménagère » -écrivait-il- et les bois sombres, les genévriers annonçant le « cher pays sauvage et inutile »(12). « Un œil pur et un regard fixe voient toute chose devant eux devenir transparente », notait Claudel, dans son œuvre La Ville. Affirmant que « seul lui importe l’essentiel », Alain-Fournier partage avec Claudel, cette quête de l’absolu et de la vérité. Le jeune homme est séduit par cet art qui émane du talent de Claudel, de traduire « quelque chose qui est tout (..), des phrases venues du fond de la primitive humanité »(13) ; il admire la faculté de Claudel, de lui donner cette atypique impression de réaliser « à chaque instant, ce que pourrait être l’art chez les personnages qu’il crée ou qu’il évoque »(14).
Se référant à l’écriture de La Jeune Fille Violaine (première version de L’Annonce faite à Marie), Henri évoque la réalité d’un « Art de paysans ». N’écrira-t-il pas à son camarade, Jacques Rivière : « Cela fait penser à ce que serait un drame joué dans des fermes et fait par des paysans, si les villes n’existaient pas et que les paysans se mêlent de faire des drames. Les paroles ne sont pas celles que la vie prononce, elles sont cherchées et contournées pour exprimer la vie des âmes ; et, à grand renfort d’images prises à la vie et aux préoccupations journalières, elles expriment des âmes, elles évoquent des vies »(15). Alain-Fournier reconnaîtra d’ailleurs, que Claudel aura « centuplé » son courage « pour accepter passionnément tout ce qui est rude, âpre »(16).
Si proche de la nature, Alain-Fournier (qui connaît bien la rudesse des mœurs rustiques, les savoir-faire et savoir-être qui émergent de la campagne où il a passé son enfance) confie avoir « détesté Paris, d’une haine de paysan » : un paysan portraitisé non dans une posture de travail ingrat mais deviné dans un cadre de vie qui évolue de l’apprivoisement de la nature à la sphère domestique. Ainsi, à la ferme de La Choltière (près de Pontleroy) où Henri est en cantonnement d’alerte, il fallait -note le jeune berrichon- « chercher au fond des grandes salles noires les paysans miséreux auprès du feu »(17). La troupe s’approprie des catégories d’espaces qui sous-tendent l’existence d’une activité agricole en filigrane : à La Choitière, la troupe dort sur la paille(18) ; dans la Vallée du Cher (du côté de Montrichard), elle investit des granges ne semblant « que des chambrées plus mal commodes »(19). À Chitenay, Henri dort deux nuits sur le pressoir(20) puis, le surlendemain, s’endort profondément sur un lit de haricots et de paille, avant de coucher dans l’écurie du cheval(21). L’accessoire de travail agricole est, dans la description de ce temps de manœuvres, détourné de son sens premier : des voitures de paysans sont empruntées pour permettre le déplacement des soldats ne pouvant plus marcher(22).
Sans doute influencé par le discours moderniste qui révèle une société en mutation marquée par l’idéologie d’une politique de masse réductrice d’écarts entre les classes sociales, Henri occulte les codes vestimentaires qui démarquent : les paysans rencontrés le dimanche, dans le bois de l’autre côté d’Écueillé, sont endimanchés(23).
En Touraine, Alain-Fournier ne sera, en fait, qu’un observateur de passage et aura peu de liens avec la population rurale locale : « La vie des habitants, nous n’y participons pas ; ce ne sont pour nous que ces croquants qui nous regardent passer, toujours rigolant, comme si à nous voir chanter, on ne puisse plus se tenir de rire, ou qui disent à la fin de la manœuvre « C’est déjà fini ! », comme des spectateurs volés »(24). Henri ajoute à propos du paysage découvert entre Montrichard et Angé : « L’immense vallée commençait à vivre, maisons blanches en pierre de taille, bouquets de peupliers, grandes perches inclinées pour les puits à fleur de terre. Mais comme on reste étranger à tout cela et de passage. La colonne vous emmène comme un chemin de fer »(25). Il précise toutefois qu’à de rares moments, cet uniforme qualifié d’anonyme, leur permet de sympathiser avec des personnes : « Et alors », estime-t-il, « il y aurait bien autre chose à dire que ces quelques mots bien arrangés pour donner l’impression d’un paysage »(26).
En effet et bien qu’il n’eût jamais dépeint les travaux agraires, il choisira de prôner l’esthétique du naturel, car il percevait dans la campagne, l’antagonisme des villes informes, surpeuplées et de cette notion d’enfermement psychologique qu’il dénonçait dans ses évocations d’espaces sans bornage : c’est bien à l’horizon (soit dans un espace non fermé) qu’apparaissent, lors des manœuvres, bois sombres et genévriers ; « aux approches de la Loire, le Cher s’élargit et la perspective qu’il ouvre sur les bois et les îles est infiniment lointaine et vague. Aucune carte et pas même la Loire n’en donne une idée »(27). À Cormery, de grands chemins herbeux s’en vont à travers les carrés de vigne et les bois(28). Près de Montrichard, la vallée du Cher est soulignée d’un côté, d’une « ligne abrupte de coteaux rocheux entre lesquels se glissent des bois de sapins noirs »(29). Sa perception des activités rurales ne sera que sensitive et l’approche du travail des paysans sera ressentie par le biais de l’ouïe : comme dans Le Grand Meaulnes (où il écoute le bruit d’un tombereau passant très loin), il n’entend rien d’autre, lors de l’une de ses étapes de manœuvres, que « le piétinement d’un grand troupeau de moutons, affolé » traversant la cour ; dans la ferme d’un petit hameau où la troupe d’Henri était cantonnée, une vache ayant perdu son veau, a beuglé toute la nuit(30).
Les notions d’esthétique paysagère et de naturalisme se substituent, ici, à celle d’âpreté des sites ruraux besogneux. Au pays de Cormery comparé à un jardin, « tout est calme », harmonieux, « exquis »(31). « Nous étions délicieusement saisis », écrit Henri à sa famille, « les hommes ne pouvaient s’empêcher de dire, c’est plus beau que la Normandie et ils ne savaient pas pourquoi. Il n y avait rien de remarquable, rien à désigner du doigt, quand ils voulaient dire ce qui était beau »(32). Alain-Fournier peaufine l’esthétique du texte et de l’image. En Touraine et dans la vallée du Cher, les filles de ferme apparaissent pour Henri, nanties de cette beauté qu’il accorde à la gent féminine dans sa nouvelle Le corps de la femme (écrit en 1907, un an plus tôt) et qu’il incarnera sous les traits d’Yvonne de Galais. « Si le mot de « femme » est prononcé », précisera Henri, dans sa nouvelle, « le vieux paysan de Beauce ou de Touraine, l’homme de toutes convenances et de toutes traditions, parlera en nous son vieux langage grave et silencieux ». Pour le futur auteur du Grand Meaulnes, « le corps de la jeune femme n’est pas quelque chose qu’on exhibe à l’auberge. Nous le savons humble et non pas triomphant, humble et gauche, et faible, et frileux ». Il renchérit : « Nous n’avons pas connu ce qu’il était sous le ciel d’Alexandrie, mais à cette heure, il s’en va là-bas, sous un grand parapluie, vers la ferme éloignée du bourg (...). Faible chose enveloppée de laine et de futaine, tel est le corps de la femme. Misérable chose, car sous l’auvent noirci de nos cheminées, nous nous transmettons tacitement cette vérité, que la chair est laide, honteuse et cachée (...). Si, gravement et secrètement, les fermières fécondes qui ont enfanté notre race, se sont dévêtues, c’est au fond de nos grandes salles obscures, auprès de nos grands lits surélevés comme des dômes. - Et la servante de « La Belle au Bois Dormant » n’est pas venue tirer le rideau, car l’alcôve paysanne est fermée depuis des siècles d’un rideau de cretonne bleue »(33). La référence au conte La Belle au Bois dormant (dont le décor est indissociable de la grâce du château d’Ussé) traduit toute la sensibilité du jeune Henri pour les contes et les châteaux, notamment ces « vieux petits châteaux romantiques » que le caporal découvre dans la vallée du Cher, près de Montrichard(34). Alain-Fournier préfère sans doute aux grands monuments architecturaux et historiques, le raffinement de ces petits châteaux aperçus le long des routes et qui lui rappellent certainement « ces châteaux de Sologne presque tous merveilleux de goût, d’élégance, de poésie dans des paysages sauvages »(35). Ces « vieux petits châteaux romantiques » tourangeaux n’émergent-ils du paysage sans évoquer pour Henri -qui cultive le goût des Romantiques pour la sacralisation des ruines et de la forêt- « la flèche d’une tourelle grise » annonçant « la longue maison châtelaine aux ailes inégales »(36) : « quelque vieux manoir » solognot, « abandonné »(37) et découvert au hasard d’une balade à bicyclette, devenu l’un des motifs ayant inspiré chez l’auteur du Grand Meaulnes, le cadre du « Pays sans nom », du « Pays perdu », celui de son enfance.
Sous la plume d’Henri Fournier, la campagne tourangelle se fait « objet d’art » et s’étoffe de l’influence des codes impressionnistes. Le jeune homme restitue scrupuleusement les variations horaires de la journée dont la lumière mouvante -en fonction de la course du soleil- façonne différemment le paysage. Ainsi, les troupes font halte en plein midi, dans un bois de sapins brûlants pour pénétrer « en déclin de la soirée, dans le pays désiré »(38). De Montrichard à Angé, Henri voit le soleil se lever avant les premiers nuages rouges et observe l’impact du soleil qui avance, sur la perception de l’environnement(39) ; il regarde « le soleil couchant d’un côté et la lune de l’autre sur Cellette ou Chitenay »(40). Au fur et à mesure que progressait le soleil, la bande de brume « se désorganisait et montait comme après le passage d’un train »(41). Le regard impressionniste -qui capte le fugitif pour mieux générer une relation entre l’individu et l’univers- incite le jeune Fournier (pourtant fasciné par le symbolisme) à poétiser les effets de la brume et de la fumée : « Il y avait », décrit-il, « une telle bande de brume au-dessus du Cher que les bouquets d’arbres des rives avaient l’air plantés sur une route de fumée »(41). Le code narratif d’Alain-Fournier cherche, comme Maupassant (en particulier dans l’œuvre L’Inutile Beauté), à suggérer une impression d’évanescence, de fugitivité voulue aérienne. Le traitement des brumes de la Vallée du Cher n’est pas sans rappeler l’évocation poétique des jeux de brumes anglais et solognots. Ainsi, dans la description du voyage d’Henri en Angleterre, la nuit sur la mer se fond dans la brume(42) : une esthétique proche de celle de Whistler. Dans sa nouvelle Le miracle de la fermière, la vallée se perd au loin, à l’image d’une rivière « toute voilée de vapeurs »(43). Certains passages du Grand Meaulnes suggèrent également cette notion de fugacité de la brume empruntée à la posture impressionniste : le maître d’école de Sainte Agathe -M. Seurel- oriente sa promenade vers un étang que couvre la brume(44), une brume qui baigne également la place de ce village(45) ; dans cette contrée qu’Henri situe en Sologne, les frais brouillards de septembre descendent avec la nuit(46). Une telle atmosphère n’est probablement pas sans réactiver, chez le jeune Henri, celle dont il fut enveloppé lors de sa sortie du Salon d’automne, un jour de 1905, à cinq heures...
Le symbole de l’eau (importante dans Le Grand Meaulnes comme dans le discours hygiéniste et les représentations littéraires naturalistes) fait aussi l’objet d’une évocation dans une correspondance d’Henri à sa famille : il y relate avoir, dans sa solitude, jeté des cailloux sur l’écume verte de l’une des trois mares de la ferme de La Choltière afin que l’écume s’ouvrît(47). La mouvance de l’eau qui, d’ordinaire, corrige l’air en luttant contre les risques pathogènes des effluves, s’avère aussi, signifiant esthétique. Dans un courrier adressé à M. Fournier, d’Azay-sur-Cher, Henri s’enthousiasme d’avoir pu, pour la première fois depuis quinze jours, se baigner dans le Cher(48). Renvoyant -comme dans l’œuvre de Maupassant (Une partie de campagne)- à la naissance et aux plaisirs vitaux, l’image de l’eau devient dans l’écriture d’Alain-Fournier, l’un des matériaux de la culture pastorale et élément de culte du discours hygiéniste. Le discours du plein air qui régénère l’organisme et a contribué à faire émerger une nouvelle esthétique du paysage, est aussi pour cet écrivain, une vertu hygiénique qui va devenir matière de roman (dans quelques chapitres du Grand Meaulnes) et s’intègre présentement dans ses pratiques. Ainsi, le 16 septembre (jour de repos), Henri profite du soleil pour se rendre à pied et à son rythme, jusqu’aux villages environnants : « J’ai pu aller en flâneur jusqu’aux pays voisins : Coulangé, Villeloin », écrit-il à son père. « Je me suis arrêté à deux fermes pour y boire du lait. La vue d’une épicerie, d’une simple devanture d’épicerie, m’était agréable comme le visage d’un ami ! »(49) : une épicerie peut-être semblable à celles d’Épineuil qui lui rappelaient alors, le souvenir des parents du « Gros Boujardon » ou de la Veuve Painchaud et de son fils campé sous les traits de Jasmin Delouche... « Derrière chaque instant de la vie, je cherche la vie de mon paradis ; derrière chaque paysage, je sens le paysage de mon paradis »(50), notera Henri.

En 1913, Alain-Fournier refera -mais cette fois-ci, en automobile- le circuit « Azay-sur-Cher, Saint-Martin-le-Beau, Montrichard ». Il sera accompagné de son amie, la comédienne Madame Simone et de l’époux de cette dernière (Claude-Casimir Périer dont il était secrétaire). Mais, nostalgique, voire peut-être psychologiquement marqué par l’ambiguïté de ses relations avec l’actrice, Henri déclarera que, pour aimer cette contrée, « il faudrait être pris entre deux clôtures de vignes, derrière le mur d’une maison vieux rose », comme dira-t-il, « je l’étais en 1908 ».
Mai 2007
Isabelle Papieau
NOTES
(1) Lettre d’Alain-Fournier à René Bichet, 6/9/1908.
(2) Lettre d’Alain-Fournier à Jacques Rivière, 9/7/1905.
(3) Rivière I., Images d’Alain-Fournier, Paris, Fayard, 1938, pp. 280-281.
(4) Le Tourangeau, 6/9/1908.
(5) Alain-Fournier, correspondance, 13/8/1905.
(6) Ibid.
(7) Lettre d’Alain-Fournier à M. Fournier, 16/9/1908.
(8) Ibid.
(9) La Touraine Républicaine, 20/9/1908.
(10) Lettre d’Alain-Former à M. Fournier, 16/9/1908.
(11) Ibid.
(12) Lettre d’Alain-Fournier à Mme Fournier, 12/9/1908.
(13) Lettre d’Alain-Fournier à Jacques Rivière, 17/2/1906.
(14) Ibid.
(15) Ibid.
(16) Lettre d’Alain-Fournier à Jacques Rivière, 21/3/1906.
(17) Lettre d’Alain-Fournier à Mme Fournier, 12/9/1908.
(18) Ibid.
(19) Ibid.
(20) Ibid.
(21) Ibid.
(22) Lettre d’Alain-Fournier à M. Fournier, 16/9/1908.
(23) Ibid.
(24) Lettre d’Alain-Fournier à Mme Fournier, 12/9/1908.
(25) Ibid.
(26) Ibid.
(27) Lettre d’Alain-Fournier à Jacques Rivière, 20/9/1908.
(28) Carte postale d’Alain-Fournier à sa famille, 8/9/1908.
(29) Lettre d’Alain-Fournier à Mme Fournier, 12/9/1908.
(30) Carte postale d’Alain-Fournier à sa famille, 8/9/1908.
(31) Ibid.
(32) Ibid.
(33) Alain-Fournier, Le corps de la femme, in Miracles, Paris, Fayard, 1986, pp. 133-134.
(34) Lettre d’Alain-Fournier à Mme Fournier, 12/9/1908.
(35) Alain-Fournier, Correspondance, 13/8/1908.
(36) Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Paris, Fayard, 1971, p. 53.
(37) Ibid.
(38) Lettre d’Alain-Fournier à Jacques Rivière, 20/9/1908.
(39) Lettre d’Alain-Fourrier, 12/9/1908.
(40) Carte postale d’Alain-Fourrier à sa famille, 8/9/1908.
(41) Lettre d’Alain-Fournier à Mme Fournier, 12/9/1908.
(42) Lettre d’Alain-Fournier à Jacques Rivière, 9/7/1905.
(43) Alain-Fournier, Le miracle de la fermière, in Miracles, Paris, Arthème Fayard, 1986, p. 200.
(44) Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Paris, Fayard, 1971, p. 15.
(45) Ibid., p. 194.
(46) Ibid., p. 146.
(47) Lettre d’Alain-Fournier à Mme Fournier, 12/9/1908.
(48) Lettre d’Alain-Fournier à M. Fournier, 16/9/1908.
(49) Ibid.
(50) Alain-Fournier, 26/1/1907.
BIBLIOGRAPHIE
Alain-Fournier, Lettres d’Alain-Fournier à sa famille (1905-1914), Paris, Émile-Paul, 1940.
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Paris, Fayard, 1971.
Alain-Fournier, Miracles, Paris, Fayard, 1986.
Papieau I., Arts et société dans l’œuvre d’Alain-Fournier, Paris, L’Harmattan, Coll. « Logiques sociales », 2006.
Rivière I., Images d’Alain-Fournier, Paris, Fayard, 1938.
La Touraine Républicaine, 17/9/1908.
La Touraine Républicaine, 20/9/1908.
La Touraine Républicaine, 25/9/1908.
|
|