Charles Péguy, sa poésie
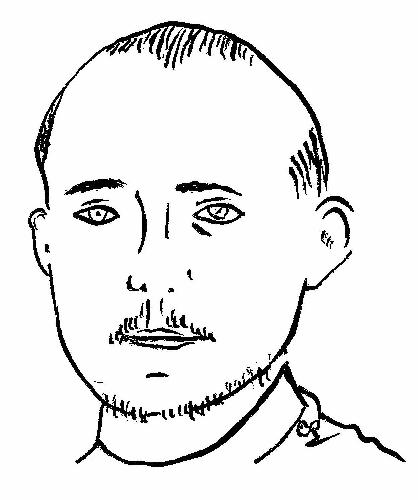
20èmes RENCONTRES LITTÉRAIRES
DANS LE JARDIN DES PRÉBENDES, À TOURS
Vendredi 17 août 2018, de 17 h 30 à 19 h
|
Charles Péguy, sa poésie |
|
Lire la présentation de cette Rencontre.
Charles Péguy, l’un des auteurs majeurs du XXe siècle, très créatif, nous laisse une œuvre abondante, multiple, diverse et forte de ses pensées. Grand travailleur, il a su allier diversité des situations et intensité créatrice. Imprégnons-nous de la force vitale de ses principales œuvres poétiques car elles ont contribué à sa célébrité toujours d’actualité.
Dès 1895, à vingt-deux ans, il prépare sa première pièce de théâtre, Jeanne d’Arc qui paraîtra en 1897. Il restera attaché toute sa vie à Jeanne comme un point de repère dans sa vie, un idéal à suivre contre vents et marées (Œuvres poétiques, Chronologie, p. XXXI). Il réserve la poésie aux moments les plus intenses, celle des prises de décisions. Il traduit par des mots, la force de sa parole, de son appel qui défie la raison humaine : incroyable ! Une humble femme voulait sauver la France après quatre-vingt années de guerre, là où les meilleurs soldats n’avaient pas réussi !

Une partie du public.
Laissons-nous gagner par la force d’émotion et de sentiments dégagés en poésie, dans le monologue de Jeanne demandant pardon à ses parents d’être partie de chez elle pour sauver la France. Admirons l’art littéraire de Charles Péguy, à travers la répétition de mots par exemple « Pardonnez-moi ». Il crée un rythme litanique, inhabituel, pouvant paraître lassant par sa lenteur, sa lourdeur, sa monotonie mais qui, utilisé à bon escient, avec art, fait jaillir avec encore plus de force, l’illumination par la foi envers et contre tout. Il traduit ainsi les états d’âme de Jeanne avec humanité et délicatesse. Il nous saisit par la force de ses images, ses visions concrètes tout à fait inhabituelles, nous emportant dans un autre monde, nous envoûtant dans une sorte d’apostolat (propagation de la foi).
(…)
O mon père, ô maman, quand on vous aura dit
Que je suis au pays de batailles et d’alarmes,
Pardonnez-moi tous deux ma partance et vos larmes,
Pardonnez ma partance et mon mensonge aussi,
Ma partance menteuse et vos souffrances lentes,
Et de vous dire adieu quand vous n’êtes pas là.
Pardonnez-moi tous deux ; et
vous aussi, mes frères,
Pardonnez tous les trois à votre sœur menteuse,
Et remplacez-moi bien auprès de notre père,
Et consolez maman de ma partance fausse,
O consolez maman de mon absence lente.
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Jeanne d’Arc, p. 82)
Dans les passages en prose, Charles Péguy peut aussi mettre en valeur des instants importants mais le plus souvent ancrés dans le concret de l’action comme les paroles sorties de la bouche du soldat Raoul de Gaucourt ébahi de la sûreté de décision de Jeanne :
(…)
– Voyons, madame Jeanne : allons un peu moins
vite, s’il vous plaît. (…) Si les principaux capitaines s’assemblent
dans votre maison, ce n’est pas pour prendre vos ordres, madame : c’est
pour tenir conseil avec vous, c’est pour que vous teniez conseil avec eux
sur ce qu’il faut faire.
Jeanne
– Mais puisque je le sais, moi, messire, tout ce
qu’il faut faire.
(…)
(id., p. 132)
Charles Péguy sait nous transmettre avec talent, la force du message de Jeanne, basé sur l’essentiel et mettre en relief son acceptation de tout pour sauver son pays. Il alterne la prose avec des passages en alexandrins. Cette pièce de théâtre est composée de trois parties, trois moments cruciaux de la vie de cette femme hors du commun :
– « A Domrémy », période de son enfance innocente en tant que bergère, inconnue de tous vers sa conscience de devoir partir pour sauver la France ;
– « Les Batailles », celle de son changement radical, de sa foi indéracinable de l’acceptation de tout et enfin
– « Rouen », celle de sa foi indéracinable, de son acceptation de tout, de sa condamnation par des hommes et de sa mort.
Dans la première partie, Charles Péguy nous emporte près de l’enfance de Jeanne et de ce bonheur qu’elle va quitter :
(…)
O Meuse inépuisable et douce de mon enfance,
Qui passes dans les prés auprès de ma maison,
C’est en ce moment-ci que je m’en vais en
France :
O ma Meuse, à présent je m’en vais pour de bon.
O maison de mon père où je filais la laine,
Maison de pierre forte, ô ma douce maison,
Je m’en vais pour de bon dans la bataille humaine,
O voici que je m’en vais m’en aller pour de bon.
(…)
(id., p. 93)
Charles Péguy a choisi d’écrire le chapitre suivant « Les Batailles » en prose peut-être pour accentuer la rapidité de l’action, des guerres, des victoires. Citons un exemple mettant en scène Raoul de Gaucourt et Jeanne d’Arc.
(…)
Raoul de Gaucourt
– Voyons, madame Jeanne, écoutez-moi bien : Voilà quarante ans passés que je fais la guerre ; j’ai fait la guerre aux Turcs ; j’ai fait la guerre, hélas à beaucoup de chrétiens pour le bien du royaume ; j’ai traîné treize ans dans les prisons des Anglais : eh bien, madame Jeanne, quand je parle, à mon tour, en conseil, je permets qu’on me discute, et même, ce que je dis, je le dis justement pour qu’on le discute. Et pourtant, voici que je vais avoir mes soixante ans sonnés. Et vous, Jeanne, vous qui êtes arrivée d’hier parmi nous, vous qui allez à peine sur vos dix-huit ans, vous ne voulez pas, mon enfant, qu’on vous discute !
Jeanne
– Monsieur de Gaucourt, il ne s’agit pas de
moi : Je n’ai rien à commander, moi, qui soit de moi. Je n’ai pas
de commandement qui soit à moi. Mais je viens de Celui qui a commandement
sur tout le monde ; et celui qui me dit ce que Dieu m’ordonne, c’est
un bien ancien capitaine aussi, monsieur de Gaucourt, un bien ancien chef de
guerre, puisqu’il menait l’armée céleste à l’assaut des maudits.
(…)
(id., pp 132 et 133)
Trois lignes situées vers la fin de ce chapitre « Les Batailles » se détachent en vers, celle de la supplication de Jeanne. La répétition du mot « seule » permet à Charles Péguy d’insister sur l’envahissement de la solitude après la gloire de la victoire et le changement qui approche, la condamnation.
(…)
O mon Dieu faudra-t-il que je sois toute seule ?
Faut-il qu’ils fassent tous leur partance de moi ?
Que leur partance à tous me laisse toute seule ?
(…)
(id., p. 205)
Dans le dernier chapitre « Rouen » écrit globalement en prose, les accusations crachées se suivent et tranchent avec le calme de Jeanne qui n’essaient pas à tout prix de vaincre cet acharnement contre elle. Charles Péguy insère des alexandrins dans les moments cruciaux, par exemple quand Jeanne prend la parole et supplie. Il s’approprie les paroles de Jeanne en employant le « je » car il souhaite lui aussi accéder au pardon et à la vie éternelle :
(…)
Faudra-t-il que je sois prisonnière damnée,
(…)
Me ressouvient le temps lointain de la lointaine enfance.
O maison de mon père où je filais la laine,
Où les longs soirs d’hiver, assise au coin du feu,
J’écoutais les chansons de la vieille Lorraine,
Faut-il que je te dise un éternel adieu ?
(…)
O mon Dieu,
Puisqu’il faut qu’à présent Rouen soit ma maison,
écoutez ma prière :
(…)
Pardonnez-moi, pardonnez-nous à tous tout le mal que j’ai fait en vous servant.
Mais je sais bien que j’ai bien fait de vous servir.
Nous avons bien fait de vous servir ainsi.
Mes voix ne m’avaient pas trompée.
Pourtant, mon Dieu, tâchez donc de nous sauver tous, mon
Dieu.
Jésus, sauvez-nous tous à la vie éternelle.
(id., pp. 308, 325 et 326)
À l’opposé, dans La chanson du roi Dagobert (1903), Charles Péguy utilise la légèreté, l’humour pour faire passer son message sur l’air de cette chanson connue. Le poète met en cause indirectement ceux qui ont le pouvoir et le cèdent sans arrière-pensée, ceux qui ont de grandes responsabilités et passent leur temps à mener une vie facile sans remords de conscience, critiquant indirectement le régime en place :
(…)
Le bon roi Dagobert
Avait un grand sabre de fer ;
Le grand saint Éloi
Lui dit : ô mon roi,
Votre Majesté
Pourrait se blesser ;
– C’est vrai, lui dit le roi,
Qu’on me donne un sabre de bois.
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, La chanson du roi Dagobert, p. 337)
(…)
Le bon roi Dagobert
Aimait le vin sec en hiver ;
Le grand saint Éloi
Lui dit : ô mon roi,
Bouteille jolie
Est la joie
Des yeux,
Bouteille ma mie
Est la joie
Des vieux ;
Lippeuse lampée
Est la joie
Des dieux ;
– Rien ne vaut le Blésois,
Le petit vin de Blois,
Vin de sable et de bois,
Rien ne vaut le Blésois
Pour chauffer mon vieux cœur de roi.
(…)
(id., p 355)
À partir de 1909, la force de sa foi devient de plus en plus visible dans ses œuvres. Il compose alors des textes mystiques qui vont assurer sa gloire posthume. Dès 1910, Charles Péguy se consacre à une intense création littéraire.
Tout d’abord, son retour à la foi a souvent laissé croire à un reniement de ses écrits antérieurs. Charles Péguy préfère le présenter comme un cheminement vers un approfondissement de son être. Dans son livre Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910), Charles Péguy manifeste publiquement sa conversion à travers une force d’écriture intense. Avec une foi indéniable, bâtie sur le roc, il donne la parole à Jeanne d’Arc :
(…) Et ce ne sont plus seulement les tentations qui nous assiègent, mais ce sont les tentations qui triomphent ; et ce sont les tentations qui règnent ; (…) pardonnez-moi, mon Dieu, de vous faire du mal à vous ; mais les bons, ceux qui étaient bons, succombent à une tentation infiniment pire : à la tentation de croire qu’ils sont abandonnés de vous. (…) mon Dieu délivrez-nous du mal, délivrez-nous du mal. (…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, pp. 371 et 372)
Charles Péguy ajoute un long récit de la Passion du Christ vu à travers les yeux de Marie, mère au cœur immense et sensible, touchée par la mort de son fils, au plus profond de son être. Il insiste sur ce drame en répétant le mot « pleurait ». Charles Péguy sait aussi laisser place à l’empreinte du temps sur la vie et lier l’histoire humaine à Jésus et à l’éternité.
(…)
Elle pleurait, elle pleurait,
Depuis trois jours elle pleurait.
(…)
Il avait été arrêté la veille au soir.
Seulement.
Elle se rappelait bien.
Ainsi.
Comme le temps passe.
Comme le temps passe vite.
Non, lentement.
(…)
Comme il sentait monter à lui sa mort humaine,
Sans voir sa mère en pleur et douloureuse en bas,
Droite au pied de la croix, ni Jean, ni Madeleine,
Jésus mourant pleura sur la croix de Judas.
(…)
Il voyait tout d’avance et tout en même temps.
Il voyait tout après.
Il voyait tout avant.
Il voyait tout pendant, il voyait tout alors,
Tout lui était présent de toute éternité.
(…)
(id., p 457, 485 et 488)
Dans la même lignée créatrice, sont nés deux autres mystères : Le Porche du mystère de la deuxième vertu (1911) et Le Mystère des saints Innocents (1912).
Dans Le Porche du mystère de la deuxième vertu, écrit en prose, Charles Péguy va souvent à la ligne pour séparer ses idées et nous aider à approfondir le sens de son œuvre. Il peut aussi laisser un mot en attente, le décaler, le répéter, le déposer au début de la ligne suivante pour souligner son importance, l’isoler pour mieux le mettre en valeur.
Est-ce encore de la prose ou de la prose poétique ? Charles Péguy a l’art de créer volontairement une atmosphère, un rythme, de capter sans cesse notre attention sans nous lasser au fil d’une histoire qui semble ne jamais finir. Nous pouvons tout d’abord être déconcertés par son style inhabituel avant d’être envoûtés.
Pour Charles Péguy, l’espérance est au cœur de sa vie. Il peut exprimer la parole de Dieu pour révéler avec délicatesse et douceur, les plus petits détails presque infimes mais grands car emplis d’amour, en lien avec l’éternité. Alors le temps est aboli ; tout devient grâce.
(…)
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du
tout.
Cette petite fille espérance.
Immortelle.
Car mes trois vertus, dit Dieu.
Les trois vertus mes créatures.
Mes filles mes enfants.
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures.
De la race des hommes.
La Foi est une Épouse fidèle.
La Charité est une Mère.
Une mère ardente, pleine de cœur.
Ou une sœur aînée qui est comme une mère.
L’Espérance est une petite fille de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année
dernière.
(…)
L’Espérance voit ce qui sera.
Dans le temps et pour l’éternité.
(…)
Espérance ; enfance du cœur.
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques Le Porche du mystère de la deuxième vertu, pp. 535, 536 et 553)
Marie, « créature unique entre toutes les créatures » (id., p 576) symbolise la naissance d’un monde nouveau car elle jaillit en opposition à un monde corrompu :
(…)
Dans ce désastre. Dans ce défaut. Dans ce manque.
Dans ce désastre de la moitié des anges et de la
totalité des hommes il n’y avait plus rien de charnel qui fût pur,
De la pureté de la naissance.
Quand un jour cette femme naquit de la tribu de Juda
Pour le salut du monde.
Parce qu’elle était pleine de grâce.
(…)
(id., pp. 576 et 577)
Après cette approche de salut, Charles Péguy lie le corps et l’âme. Il nous sensibilise au concret de la mort humaine en se tournant vers l’immortalité, non pas en opposition mais en complémentarité, l’une étant liée à l’autre dans l’éternité. Malgré tout, Charles Péguy exprime la douleur en lien avec la paix :
(…)
Ils ne connaissent point cette liaison mystérieuse,
cette liaison créée,
Infiniment mystérieuse,
De l’âme et du corps.
(…)
Cet attachement, cette liaison du corps et de l’âme,
D’un esprit et d’une matière,
De l’immortel et du mortel mais qui ressuscitera
Et l’âme est liée à la boue et à la cendre.
(…)
En confiance,
En espérance.
(…)
(id., pp. 579 et 614)
Charles Péguy peut nous déconcerter, nous entraînant dans une sorte de danse valsant de tout côté, en lien avec l’histoire à travers deux femmes, Rebecca et la Samaritaine. Il rend aussi hommage à la nuit comme à une mère qui prendrait soin de nous avec sensibilité et humanité, en complémentarité avec la lumière, l’eau symbolisant l’effacement des souillures pour nous faire revivre :
(…)
Nuit tu es une belle invention
De ma sagesse.
Nuit ô ma fille la Nuit ô ma fille silencieuse
Au puits de Rebecca, au puits de la Samaritaine
C’est toi qui puises l’eau la plus profonde
Dans le puits le plus profond
O nuit qui berces toutes les créatures
Dans un sommeil réparateur.
O nuit qui laves toutes les blessures
Dans la seule eau fraîche et dans la seule eau profonde
Au puits de Rebecca tirée du puits le plus profond.
Amie des enfants, amie et sœur de la jeune Espérance
O nuit qui panses toutes les blessures
(…)
(id., pp. 665 et 666)
Charles Péguy composa ensuite Le Mystère des saints Innocents, écrit en prose, à l’occasion du 423e anniversaire de la délivrance d’Orléans (le 8 mai 1912) (Charles Péguy, Œuvres poétiques, Introduction, p. XIII). Dans ce livre, l’auteur partage avec nous, le mystère du pardon pour tous, dans ce contexte de guerre latente, propice à cette révélation. Il exprime sa confiance au plus profond de la détresse, son espérance dans la force des faibles, des enfants symbolisés par l’écume fragile et pourtant toujours là, envers et contre tout. Il reconnaît la force de l’innocence de l’enfant :
(…)
Le monde est toujours à l’envers, dit Dieu.
Et dans le sens contraire.
Heureux celui qui resterait comme un enfant.
Et qui comme un enfant garderait
Cette innocence première.
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Le Mystère des saints Innocents, p. 785)
Charles Péguy peut utiliser la prose ou la poésie en des vers de longueur variable, ne rimant pas obligatoirement. Étonnamment le rythme est conservé par la disposition de certains mots, par exemple la répétition des mots « tant », « écume », et aussi la répétition du suffixe « ude ». Ce mouvement de balancier donne force et vie au message du poète qui nous emporte en final en voyage, près de l’écume, empreinte légère et fugace, près de l’ancrage de la folie humaine et de la cruauté. De même, il peut utiliser des alexandrins puis sans ordre précis, des vers plus courts de six ou de trois pieds pour faire ressortir l’idée qu’ils contiennent, « écume », « haine » avant de reprendre cette litanie à travers des vers de longueur variable pour exprimer la fuite de la vie, ses cahots et toujours la présence fragile de l’amour :
(…)
Sur tant de lassitude et de sollicitude.
Sur tant d’ingratitude et d’inexactitude.
Sur tant d’incertitude et tant de solitude.
Et tant de servitude et de désuétude.
Et tant de platitude et sur tant d’amertume.
Et sur cette écume
De sang.
Et sur cette écume
De haine.
Et sur cette écume
D’ingratitude.
Et sur cette écume
D’amour.
(…)
(id., p 745)
Charles Péguy met l’enfant à la première place dans la simplicité et la vérité de son cœur à côté des enfants tués, des adultes trop souvent dépravés. Quand les enfants sont morts, il les habille de grâce, « fleurs des Martyrs » (id., p. 821) avec un « M » majuscule pour les magnifier dans leur pureté :
(…)
Car il y a dans l’enfant, car il y a dans l’enfance
une grâce unique.
Une entièreté, une premièreté
Totale.
(…)
(id., p. 788)
Il se laisse aussi guider par l’intuition, envers et contre tout, donnant la première place à l’enfant au-delà de la cruauté humaine et de la mort :
(…)
Une ruée de brutes passa (…)
Des cris, des dents. Des regards luisants.
(…)
Il n’y eut plus dans le sang et dans le lait
Qu’une grande jonchée de corps morts
(…)
Ces yeux qui s’étaient à peine ouverts à la lumière
du soleil terrestre
Pour éternellement furent clos à la lumière du soleil
terrestre.
Ces yeux qui s’étaient à peine ouverts à la lumière
du soleil temporel
Pour éternellement furent clos à la lumière du soleil
temporel.
(…)
Salvete flores Martyrum, ces enfants de moins de deux
ans sont les fleurs de tous les autres Martyrs.
(…)
Promesse de tant de martyrs, ils sont les boutons de rose
De cette rosée de sang.
(…)
(id., pp. 812, 821 et 822)
Ce n’est pas un hasard si Charles Péguy réalise deux pèlerinages à la cathédrale de Chartres, l’un en 1912 et le second en 1914 pour que son fils malade guérisse. Il reste un chercheur en marche, sur le chemin vers un ailleurs.
Son œuvre Les Sonnets est composée de trois poèmes formant une vision prophétique ou apocalyptique : Dans « L’épave », tout s’écroule dans un naufrage. Nous perdons nos repères et pourtant Charles Péguy affirme la venue d’ « Un jour plus solennel que le jour de la mort » (Charles Péguy, Œuvres poétiques, Les Sonnets, p. 827). Dans « L’urne », il se sert des mots « regret révéré », « limon plus sacré que la cendre d’un mort », « poussière amassée » (id., p. 827) quand tout disparaît dans l’épouvante. Enfin dans « L’aveugle » formé de deux sonnets distincts (marqués I et II), nous pénétrons « d’innombrables rayons de toutes les lumières », « d’innombrables regards vers la terre et les cieux », « d’innombrables reflets des ténèbres premières », « d’innombrables regrets vers le monde et les dieux » (id., p. 828) avant que toute vie s’efface sauf celle d’un aveugle. L’ensemble forme une vision futuriste, apocalyptique et en même temps, étonnante car elle inclue des repères de la mythologie ancienne dont « Homère » (id., p. 828) avant la sentence finale inattendue, puisqu’elle nous transmet l’image du règne éternel d’un aveugle vagabond :
(…)
Que d’autres soient savants de tout ce qui se
sait :
L’aveugle vagabond sera toujours le maître,
Sous tout ce qui se dit, de tout ce qui se tait.
(id., p. 829)
Par la suite, Charles Péguy privilégie de plus en plus, de longues litanies et une poésie à forme fixe. Si le poète choisit le mot « sept » pour deux titres de ses œuvres, ce n’est pas un hasard. Le poète a certainement voulu rester en lien avec le temps qui passe, les sept jours de la semaine et aussi avec les sept jours de la création, en attente de la fin du monde. Ainsi, dans Les sept contre Thèbes, œuvre très courte de trois pages, constituée de quatrains en alexandrins pour plus de solennité, nous plongeons dans une vision alliant mythologie, ambiance de fin du monde, de jugement dernier dans une vision de condamnation avec les mots « inexpiable », « déicide » (Charles Péguy, Œuvres poétiques, Les sept contre Thèbes, p. 832) avant un espoir de résurrection :
(…)
Deux mondes contemplaient la porte solennelle.
Tout un peuple couché vers les genoux des dieux,
Tout un peuple courbé sous la fureur des cieux
Savait qu’elle serait la porte Fraternelle.
(…)
(id., p. 831)
Charles Péguy met aussi l’eau à l’honneur car elle symbolise le temps qui passe. Il nous emporte alors sur les bords de ce fleuve grandiose, près des Châteaux de Loire pour célébrer la beauté en l’associant à l’esthétique architecturale, écrin pour introduire l’enfant qui sera bientôt l’étendard à suivre pour sauver la France :
CHATEAUX DE LOIRE
Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,
Et dans la majesté des matins et des soirs
La Loire et ses vassaux s’en vont par ces allées.
Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise,
Plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais.
Ils ont nom Valençay, Saint-Aignan et Langeais,
Chenonceaux et Chambord, Azay, le Lude, Amboise.
Et moi j’en connais un dans les châteaux de Loire
Qui s’élève plus haut que le château de Blois,
Plus haut que la terrasse où les derniers Valois
Regardaient le soleil se coucher dans sa gloire.
La moulure est plus fine et l’arceau plus léger.
La dentelle de pierre est plus dure et plus grave.
La décence et l’honneur et la mort qui s’y grave
Ont inscrit leur histoire au cœur de ce verger.
Et c’est le souvenir qu’a laissé sur ces bords
Une enfant qui menait son cheval vers le fleuve.
Son âme était récente et sa cotte était neuve.
Innocente elle allait vers le plus grand des sorts.
Car celle qui venait du pays tourangeau,
C’était la même enfant qui quelques jours plus tard,
Gouvernant d’un seul mot le rustre et le soudard,
Descendait devers Meung ou montait vers Jargeau.
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Châteaux de Loire, p. 833)
À partir de 1912, les écrits de Charles Péguy traduisent de plus en plus joie, espérance, foi rayonnante présente dès sa jeunesse, force de la douceur et de l’enfance. Il entreprend son ensemble Les Tapisseries comprenant La tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc (1912), La tapisserie de Notre Dame (1913). Le titre de cet ensemble pourrait nous paraître étonnant mais nous pouvons le lier à son passé. Charles Péguy a tant vu sa mère passer des journées entières à rempailler des chaises pour gagner le minimum vital, sa grand-mère à travailler du matin au soir pour entretenir la pauvre demeure, son père étant mort. Il a su très tôt l’importance du travail réalisé point après point, patiemment, avançant, reculant pour à nouveau avancer comme dans une tapisserie où l’ensemble finit par représenter une grande œuvre belle à regarder. Ainsi il a ciselé ses vers, les uns après les autres, en alexandrins, n’hésitant pas à répéter des mots, des morceaux de phrases. Ainsi la vie se construit pas à pas, point après point.
Dans La tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc, Charles Péguy célèbre la vie du « Premier jour pour le vendredi 3 janvier 1913 fête de sainte Geneviève quatorze cent unième anniversaire de sa mort » (Charles Péguy, Œuvres poétiques, La tapisserie de sainte Geneviève, p. 839) au « Neuvième jour pour le samedi 11 janvier 1913 » (id., p. 876). Il nous propose des images venues du fond des temps vers nous, des guerres, des douleurs, des cruautés face à l’innocence prête à vaincre l’impossible au regard humain :
(…)
Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre,
On la mit à garder un bien autre troupeau,
La plus énorme horde où le loup et l’agneau
Aient jamais confondu leur commune misère.
(…)
Il fallut qu’elle vît par ce vagabondage
Retourner ce passé dont nous nous éloignons,
Il fallut qu’elle vît les maux que nous soignons
Monter le long de nous comme un échafaudage ;
(…)
Pour qu’elle vît venir du fond de la campagne,
Au milieu de ses clercs, au milieu de ses pages,
Vers l’arène romaine et la roide montagne,
Traînant les trois Vertus au train des équipages,
Sa plus fine et plus ferme et plus douce compagne
Et la plus belle enfant de ses longs patronages.
(id., pp. 839, 877 et 880)
Charles Péguy sait aussi quitter le réel pour un ailleurs mystique. Dans Les sept contre Paris (1913), composé d’un sonnet sur « Paris » suivi d’un ensemble de trente quatrains, « La banlieue », il nous projette dans un univers presque irréel et en même temps, bien concret puisqu’il met en scène de nombreux lieux parisiens dont « Montmartre », « La Villette ». Tout au long de cette litanie, le mot « Elle » en début de vers, revient comme un leitmotiv. Ce n’est pas un hasard si Charles Péguy termine ces deux ensembles par le vers « Sous le commandement des tours de Notre-Dame » :
(…)
Elle a mis pour toujours les matins et les soirs,
Et les processions parmi les reposoirs,
Et les enfants de chœur avec les encensoirs,
Et les étangs coulant dessus les déversoirs ;
(…)
Elle a mis pour toujours le printemps et l’automne,
Et le blé dans le sac et le vin dans la tonne
Et le pain dans le four et toute autre patronne
Et toute autre paroisse et toute autre madone
Sous le commandement des tours de Notre-Dame.
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Les sept contre Paris, pp. 884 et 887)
La tapisserie de Notre Dame (1913) est caractéristique de son élan poétique en alexandrins, commençant par la présentation de Paris :
Étoile de la mer voici la lourde nef
Où nous ramons tout nuds sous vos commandements ;
Voici notre détresse et nos désarmements ;
Voici le quai du Louvre, et l’écluse, et le bief.
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, La tapisserie de Notre Dame, p. 893)
Après quatre poèmes sur Paris, Charles Péguy nous emporte à nouveau près de l’ « Étoile de la mer » dans la Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres :
Étoile de la mer voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l’océan des blés
Et la mouvante écume et nos greniers comblés,
Voici votre regard sur cette immense chape.
(…)
(id., p. 896)
Suivent de longues litanies avec répétition de mots devenant prière. Charles Péguy cite Orléans, sa vie natale, et la Loire toujours de passage (id., p. 897), symbole de beauté et de grandeur, dans sa majesté changeante :
(…)
Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux.
Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux
Un reposoir sans fin pour l’âme solitaire.
(…)
Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau,
Dans le recourbement de notre blonde Loire,
Et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire
N’est là que pour baiser votre auguste manteau.
Nous sommes nés au bord de ce plateau,
Dans l’antique Orléans sévère et sérieuse,
Et la Loire coulante et souvent limoneuse
N’est là que pour laver les pieds de ce coteau.
(…)
Nous ne demandons rien, refuge du pécheur,
Que la dernière place en votre Purgatoire,
Pour pleurer longuement notre tragique histoire,
Et contempler de loin votre jeune splendeur.
(id., pp. 896, 897 et 907)
Dans Les cinq prières à la cathédrale de Chartres incluses dans La tapisserie de Notre Dame, Charles Péguy se laisse guider par un élan poétique à la fois grandiose et délicat. Il présente un monde fait de rébellion et de larmes en cinq parties : « Prière de résidence », « Prière de demande », « Prière de confidence », « Prière de report » et « Prière de déférence ».
Partout règnent l’expression de sa foi, la grandeur de la confiance dans l’humilité, la force de l’invisible, de la prière qui agit envers et contre tout. Voici le final grandiose par l’expression de l’humilité, de la fragilité humaine reconnue et de la demande de grâce :
(…)
Et l’amour le plus mûr et le plus plein de peine,
Et le plus plein de deuil et le plus plein de larmes,
Et le plus plein de guerre et le plus plein d’alarmes,
Et le plus plein de mort au seuil de cette plaine.
Et pour le plus gonflé du plus ancien sanglot,
Et pour le plus vidé de la vieille amertume,
Et pour le plus lavé de la plus basse écume,
Et pour le plus gorgé du plus antique flot.
Et pour le plus pareil à cette lourde grappe,
Et pour le plus astreint aux treilles de ce mur,
Et pour le plus contraint comme pour le plus sûr,
Et pour le plus pareil à ce pli de la nappe.
Et nul ne passera dans cette certitude,
Pour l’amer souvenir et le regret plus doux,
Et le morne avenir et l’éternel remous
Des vagues de silence et de sollicitude.
Et nul ne franchira le seuil de cette tombe,
Pour un culte éternel encor que périssable,
Et le profond remous de ces vagues de sable
Où le pied du silence à chaque pas retombe,
Qui ne soit incliné vers vos sacrés genoux
Et ne soit sous vos pieds comme un chemin de feuille,
Et ne consente et laisse et ne prétende et veuille,
De l’épaisseur d’un monde être aimé moins que
vous.
(id., p. 924)
En décembre 1913, Charles Péguy publie sa dernière œuvre poétique, Ève (1913), immense poème mystique de plus de 7000 alexandrins écrits sous la force de l’inspiration telle une prémonition de l’urgence de sa tâche et de l’arrivée de la guerre. Il a rédigé cet ensemble, d’un seul souffle, sans brouillon. Son fils Marcel Péguy écrit : « Ève fut écrite à une cadence des plus vives, dans les cent vers par jour, mon père composant parfois en dormant, et n’ayant plus qu’à écrire ses quatrains le matin au réveil. » (Charles Péguy, Œuvres poétiques, Notice, p. 20).
Dans cette épopée, Charles Péguy rend un hommage émouvant à toutes les femmes qui ont élevé leur enfant dans l’amour et le respect du travail bien fait. Dans cette vision prophétique, des peuples de toute race, de toute culture, des femmes défilent dans un long cortège depuis la première femme ayant enfanté, à celles ayant donné la vie et travaillé inlassablement sans bruit. En recherche, toutes portent un message d’amour ou de haine, de tendresse ou de violence.
Malgré notre petitesse, Charles Péguy nous confie à Ève, premier maillon vers Marie, en lien avec d’autres femmes telles sa mère et sa grand-mère, qui l’ont élevé avec très peu de biens matériels mais toujours beaucoup d’amour. Ève reste pour lui le symbole de l’éternel féminin, grande dans ses humbles tâches de la vie quotidienne, à peine visibles et pourtant essentielles :
(…)
Vous n’avez enfanté qu’une race plaintive,
Tantôt rivée au sol, tantôt victorieuse,
Tantôt martyre et sainte, et sage ou furieuse,
O mère et c’est ma race et la race captive
Constamment accotée aux murs de sa prison
Et vous seule vivace et seule industrieuse,
Vous vous dépensez toute, ô seule besogneuse,
À laver la vaisselle et ranger la maison.
(…)
Vous qui prenez ce bois pour allumer la lampe
Et la mettre au milieu de la table servie,
Et qui prenez ce lin pour essuyer la rampe,
Et qui rangez les fleurs et qui rangez la vie,
(…).
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Ève, p. 953)
Cet ensemble reste très vivant même dans les descriptions de mort car Charles Péguy, très tôt marqué par la mort de son père des suites de la guerre de 1870, demande aide et soutien à la mère du bon secours en utilisant le « vous » dans un dialogue respectueux. Il reconnaît la fragilité humaine et demande pitié et pardon pour tous :
(…)
Seule vous le savez nos pudeurs d’aujourd’hui
Ne valent pas le quart de l’antique ignorance.
Et les réservements de notre prude ennui
Ne sont que les témoins d’une morne insolence.
(…)
Seule vous le savez, nos contemplations
Sont troubles du dedans, ô mon âme ô ma mère.
Seule vous le savez, nos méditations
Sont vides du dedans, aïeule de misère.
(…)
(id., pp. 1007 et 1008)
À l’approche de la guerre de 1914, les écrits de Charles Péguy sont imprégnés de mort latente. Il demande grâce pour tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, quelques soient leurs fautes, leurs égarements. Ses paroles sont encore plus émouvantes car il reconnaît humblement la fragilité humaine et n’oublie pas notre condition mortelle. Alors, dans un élan salvateur, il demande pitié et pardon pour tous et le mot « Mère » revient sans cesse comme un phare sur la route humaine :
(…)
Mère voici vos fils qui se sont tant battus.
Qu’ils ne soient pas pesés comme Dieu pèse un ange.
Que Dieu mette avec eux un peu de cette fange
Qu’ils étaient en principe et sont redevenus.
Mère voici vos fils qui se sont tant battus.
Qu’ils ne soient pas pesés comme on pèse un démon.
Que Dieu mette avec eux un peu de ce limon
Qu’ils étaient en principe et sont redevenus.
Mère voici vos fils qui se sont tant battus.
Qu’ils ne soient pas pesés comme on pèse un esprit.
Qu’ils soient plutôt jugés comme on juge un proscrit
Qui rentre en se cachant par des chemins perdus.
Mère voici vos fils et leur immense armée.
Qu’ils ne soient pas jugés sur leur seule misère.
Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre
Qui les a tant perdus et qu’ils ont tant aimée.
(…)
(id., p. 1031)
Maintenant, relions les œuvres de Charles Péguy à celles de son ami de jeunesse Henri Bergson (1859 – 1941). Ce philosophe, l’un des plus grands penseurs spiritualistes du XXème siècle s’accompagnant d’un rationalisme prudent et réservé, était encore aux côtés de Charles Péguy avant son départ à la guerre de 1914. Créons une passerelle entre leurs idées et les thèmes essentiels qu’ils ont tous deux abordés.
Dans L’évolution créatrice, Bergson nous montre qu’intuition et imagination peuvent traverser des domaines que la pensée logique ne saurait atteindre. Il pressent que l’intelligence ne suffit pas à la création : « L’intelligence, par l’intermédiaire de la science qui est son œuvre, nous livrera de plus en plus complètement le secret des opérations physiques ; (…). Mais c’est à l’intérieur même de la vie que nous conduirait l’intuition (…). » (Henri Bergson, L’évolution créatrice, p. 645)
De même, Charles Péguy sait voir avec les yeux du cœur, l’importance d’un fait à peine visible dans l’immensité de la création du monde : « C’est l’innocence qui croît et c’est l’expérience qui décroît. / C’est l’innocence qui naît et c’est l’expérience qui meurt. » (Charles Péguy, Œuvres poétiques, Le Mystère des saints Innocents, p. 788)
Au niveau mystique, Bergson et Charles Péguy entrent en résonnance ; ils sont tous deux en quête de Dieu.
Bergson l’a affirmé encore plus au seuil de la mort (le 8 février 1937). Il reste déterminé, courageux même dans la déchéance physique, à l’approche de son passage vers l’au-delà : « Je me serais converti si je n’avais vu se préparer depuis des années (…) la formidable vague d’antisémitisme qui va déferler sur le monde. J’ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés. Mais j’espère qu’un prêtre catholique voudra bien, (…) venir dire des prières à mes obsèques. » (cité par Michel Laurencin, Dictionnaire Biographique de Touraine, p. 84) Dans son livre Les Deux Sources de la morale et de la religion, il témoigne aussi de la place du mysticisme dans sa vie : « [la prière] est une élévation de l’âme, qui pourrait se passer de la parole. » (Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 1146)
La foi de Charles Péguy est moins enracinée dans le concret de sa vie mais il se rapproche de la pensée de son maître dans ses écrits mystiques dont Jeanne d’Arc, Le Mystère de la Charité, Ève… ou quand il met à l’honneur « foi », « charité », « espérance ». (Charles Péguy, Œuvres poétiques, Le porche de la deuxième vertu, p. 565)
Du côté temporel, Bergson et Péguy sont deux écrivains dont les œuvres s’étalent dans la durée de toute leur vie d’adulte. Charles Péguy commence à être plus connu dans la dernière partie de sa vie alors que Bergson est remarqué dès sa thèse de doctorat, Essai sur les données immédiates de la conscience, et dès son premier livre Matière et Mémoire. Onze ans plus tard, à quarante-huit ans, Bergson publie L’évolution créatrice qui pourrait être mis en relation avec la plus longue œuvre de Charles Péguy, de 7644 vers en alexandrins, Ève, traversant les siècles, matière de chair et mémoire de l’histoire.
Bergson publie à soixante-douze ans, Les Deux Sources de la morale et de la religion, alliant minutie, conscience, réflexion, tout en restant humble : « L’homme est le seul animal dont l’action soit mal assurée, qui hésite et tâtonne, qui forme des projets avec l’espoir de réussir et la crainte d’échouer. » (Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 1149)
Charles Péguy partage avec lui, le sens du devoir, de l’exactitude, même s’il s’en différencie par l’empreinte du rêve dans de longues énumérations d’un peuple en marche, dans la campagne décrite avec soin près de la lumière de l’étoile, guide sur notre chemin comme dès le début de la Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres :
(…)
Et voici votre voix sur cette lourde plaine
Et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés,
Voici le long de nous nos poings désassemblés
Et notre lassitude et notre force pleine.
Étoile du matin, inaccessible reine,
Voici que nous marchons vers votre illustre cour,
Et voici le plateau de notre pauvre amour,
Et voici l’océan de notre immense peine.
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, La Tapisserie de Notre Dame, p. 896)
Matière et mémoire sont deux éléments importants dans l’œuvre de Bergson et celle de Charles Péguy. Bergson exprime le lien entre le corps et l’esprit : « La mémoire, pratiquement inséparable de la perception, intercale le passé dans le présent, (…) » (Bergson, Matière et mémoire, p. 219). Charles Péguy se rapproche de cette pensée dans ses longues descriptions associant la vie et la mort, l’histoire ancienne et le jour vécu par exemple en unissant la première femme du monde Ève à Jeanne d’Arc :
(…)
Et l’une est morte ainsi d’une mort solennelle
Sur ses quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-douze ans
Et les durs villageois, et les durs paysans,
La regardant vieillir l’avaient crue éternelle.
Et l’autre est morte ainsi d’une mort solennelle.
Elle n’avait pas passé ses humbles dix-neuf ans
Que de quatre ou cinq mois et sa cendre charnelle
Fut dispersée aux vents.
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Ève, p. 1174)
Bergson et Charles Péguy ont compris que l’intelligence et la connaissance ne suffisaient pas dans la vie. Dans L’évolution créatrice, Bergson pressent l’importance du subjectif et de l’intuition : « Il y a des choses que l’intelligence seule est capable de chercher, mais que, par elle-même, elle ne trouvera jamais. Ces choses, l’instinct seul les trouverait ; mais il ne les cherchera jamais. » (Bergson, L’évolution créatrice, p. 623)
Charles Péguy, après avoir vécu dans le concret de la vie quotidienne dans son enfance, laisse ensuite de plus en plus de place à une pensée forte, à mi-chemin entre prémonition et réflexion, délicatesse du geste et charité spontanée dans la vie de tous les jours. Voici deux extraits montrant l’importance de la fragilité apparente qui contient en germe, une révélation inouïe par exemple à travers un tout petit enfant :
(…)
Avons-nous essuyé de nos mouchoirs de poche
Ces yeux perdus de larme et ce front ruisselant.
Avons-nous essuyé du linge le plus blanc
Notre plus proche frère et notre ami plus proche.
(…)
Ainsi l’enfant dormait dans sa première aurore.
Il allait commencer quelle immense saison
Ainsi l’enfant dormait et reposait encore
Avant de commencer quelle immense maison.
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Ève, pp. 1060 et 1061)
Bergson et Charles Péguy ont tous deux connu l’angoisse d’un choix à faire en conservant le sens du devoir. Bergson, imprégné d’intuition métaphysique dans le temps et l’espace, hésite entre interdiction, autorité et principes moraux, établis pour maintenir un certain ordre. Il affirme que nous n’avons pas toute liberté car « l’angoisse morale est une perturbation des rapports entre ce moi social et le moi individuel. » (Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 988)
Dans une prise de position courageuse et résolument moderne, Bergson reconnait l’alternance du bien et du mal présent en nous : « l’humanité aime le drame » (Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 1228), « L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits. » (id., p. 1245)
Pour Péguy, l’obligation et le sens du devoir ont toujours primé dès sa jeunesse, comme lorsqu’il écrit « je » dans sa pièce Jeanne d’Arc pour se mettre dans la peau de Jeanne bientôt condamnée à Rouen :
(…)
Faudra-t-il que je mène en la bataille en bas
Tous ceux que j’ai tués, tous ceux que j’ai damnés,
(…)
Tous ceux que j’ai menés en la bataille humaine ;
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, Jeanne d’Arc, p. 307)
Charles Péguy reconnaît souvent l’empreinte du bien et du mal par exemple à travers les paroles franches et directes de Jeanne d’Arc qui n’hésite pas à expliquer et affirmer son amour à sa famille même après son départ :
(…)
Et j’aime étrangement ceux que j’aimais déjà,
Car je sens comme on aime alors qu’on est
fidèle ;
Mon âme sait aimer ceux qui ne sont pas là ;
Mon âme sait aimer ceux qui restent loin d’elle.
(…)
(id., p. 94)
Charles Péguy ressent la douleur du choix et l’exprime à travers le désespoir de Jeanne à l’approche de sa condamnation :
(…)
Et moi je serais là
Sans avoir un espoir d’espérance à jamais
D’apaiser la douleur d’un seul des douloureux
D’en consoler un seul du mal fou de l’absence,
(…)
(id., p. 313)
Ainsi, par cette mise en correspondance de leurs écrits, nous comprenons mieux qu’entre le maître Bergson et l’élève toujours respectueux, Charles Péguy, une amitié sincère et profonde ait existé en même temps qu’un échange littéraire fort, dans le respect de leur personnalité et de leur message dont la force est toujours d’actualité.
En conclusion, les écrits de Charles Péguy entrent en résonnance avec le XXIème siècle. Ils ne peuvent nous laisser indifférents car le poète aborde des thèmes essentiels, reflets de sa pensée toujours sincère, intense et étonnante de modernité, héroïque, prophétique, visionnaire, imprégnée d’humanité et d’une force inouïe telle dans ces quatre vers :
(…)
Voici la nudité, le reste est vêtement.
Voici le vêtement, tout le reste est parure.
Voici la pureté, tout le reste est souillure.
Voici la pauvreté, le reste est ornement.
(…)
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, La tapisserie de Notre Dame, p. 903)
Août 2017 / août 2018
Catherine Réault-Crosnier
Bibliographie :
– Péguy Charles, Œuvres poétiques complètes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, Paris, 2000, 1610 pages.
– Péguy Charles, Œuvres en prose complètes, Tome I, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, Paris, 1987, 1934 pages.
– Bergson Henri-Louis, Œuvres, Presses Universitaires de France, Paris, 2001, 1628 pages.
– Réault-Crosnier Catherine, Bergson, un philosophe hôte de la Touraine, « Rencontre littéraire dans le jardin des Prébendes » du 22 août 2014, document polycopié, 16 pages.
|
|