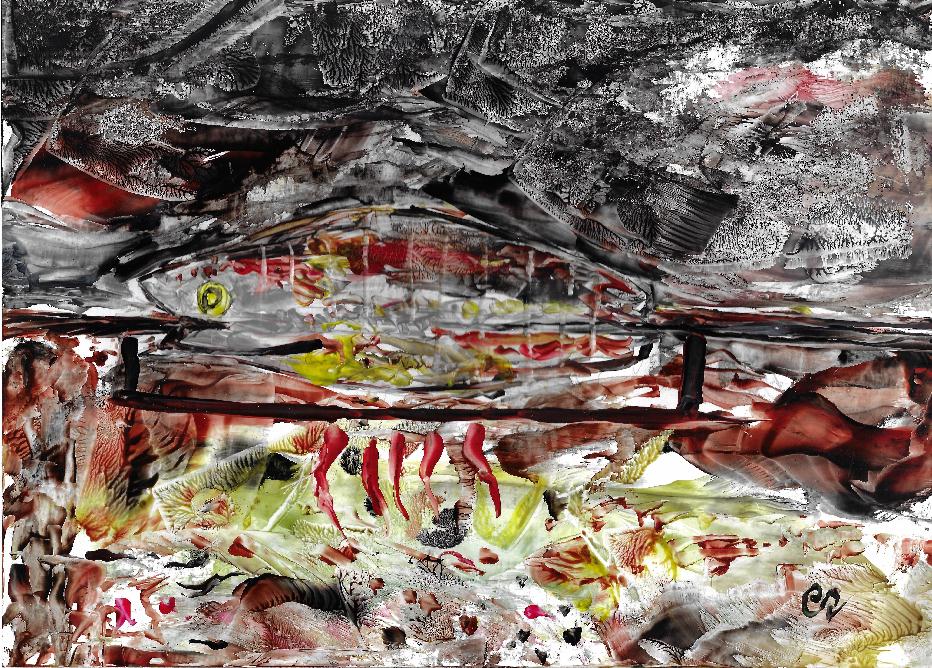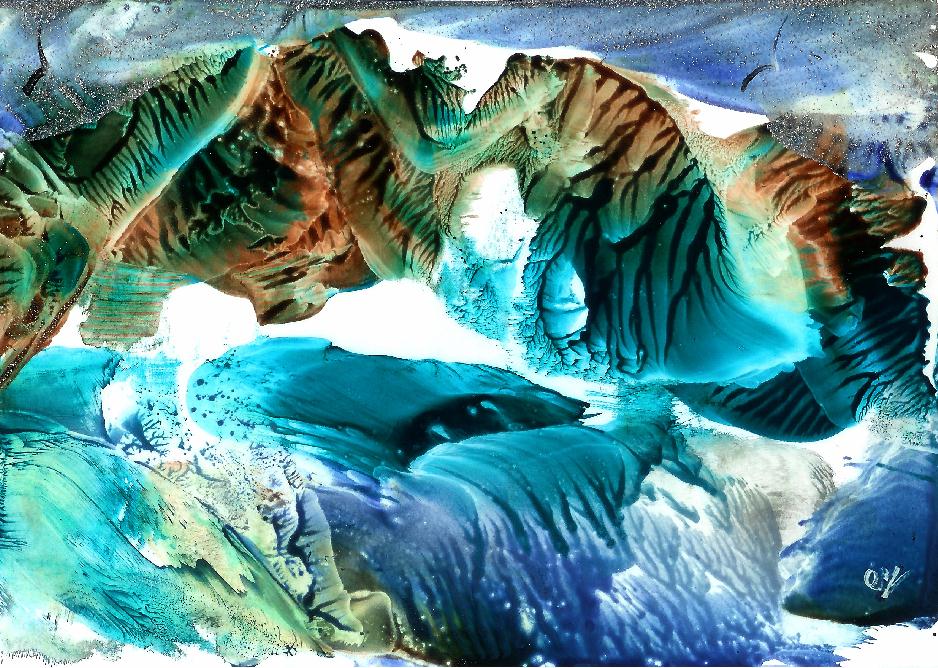Maurice Rollinat était connu comme poète, musicien mais aussi pêcheur à la ligne !
Cette passion trouve son origine lors de ses séjours dans le domaine de Bel-Air, acquis par ses parents en avril 1850, sur la commune de Ceaulmont. Là, François Rollinat aimait venir se ressourcer et oublier son travail et ce fut un véritable paradis pour Maurice Rollinat enfant. Son père, lors des promenades, lui apprend à observer la nature. Il en gardera le souvenir toute sa vie.
La Creuse est toute proche ; Maurice Rollinat adolescent aime y aller à la pêche comme il le dit dans le poème de jeunesse qui suit :

La pêche.
La pêche me procure une volupté douce :
à l’abri du soleil, sous un peuplier vert,
J’aime à jeter dans l’onde, étendu sur la mousse,
mon claveau caché sous le ver.
Dans le pays charmant, où se plût mon enfance,
La gibecière au dos, et la ligne à la main,
Je vais marcher enfin, écolier en vacances,
Sur les cailloux blancs du chemin.
Ce frais chemin conduit aux rives de la Creuse
où folâtrent la carpe, et le gougeon lutin ;
c’est à cette rivière, où ma ligne trompeuse
Va chercher son frêle butin.
L’oiseau chante gaiement tout le long de ma route ;
Et charme les échos de ses joyeux accents ;
Les fleurs, où la rosée a déposé sa goutte
Parfument l’air d’un pur encens.
Aux bords des clairs ruisseaux des grenouilles timides,
sur le gazon fleuri se chauffent au soleil ;
et rentrent d’un seul bond dans les grottes
limpides
sitôt qu’on leur donne l’éveil.
Parfois un paysan conduisant sa charrette
Passe avec ses grands bœufs qui marchent lentement,
Parfois, près d’un lavoir, une blonde fillette
Tord dans ses bras son linge blanc.

Quel plaisir, quand au loin, du haut de la colline,
Je vois le vaste pont superbement jeté,
et que j’entends le bruit de l’onde cristalline,
Roulant sur le sable argenté !…
Je descends les coteaux dominant la rivière
Par de petits sentiers serpentant dans les bois ;
Toujours en descendant, je vois quelque bergère
fredonnant parmi ses brebis.
Sur le flanc des rochers, sont des chèvres mutines
qui broutent des brins d’herbe apportés par le vent.
Le chien fait retentir ses échos des collines
De son monotone aboîement.
J’arrive au bord de l’eau : je me cherche
une place
ou règnent la fraicheur, le silence, et la paix,
et j’attends humblement, que le poisson vorace
veuille bien mordre tout exprès.
aussi, ma patience a toujours bonne aubaine :
je retire souvent un beau petit poisson,
qui, pris, sans le savoir par ma ligne inhumaine,
Frétille au bout du hameçon !
Et quand j’ai pris de quoi faire une ample friture,
Je regagne à pas lents, mon logis, vers le soir…
La brise à mon oreille apporte un doux murmure…
et la lune brille au ciel noir !
avril. (sans précision d’année)
(Poèmes de jeunesse proposés par Catherine Réault-Crosnier et Régis Crosnier, pages 27 et 29)

Pendant sa période parisienne, il rêve de venir en vacances à Bel-Air et voici ce qu’il écrit à son ami Raoul Lafagette, le 28 octobre 1874 :
« (…)
Et puis, je pourrai pêcher tout mon saoul ! J’aurai
un complet arsenal d’ustensiles de pêche : hameçons, appâts
préparés, canne à ligne, lignes de toute espèce, corde à anguilles,
etc. Si vous n’aimez pas passionnément la pêche à la ligne, vous ne
pouvez pas imaginer, mon cher ami, tout le charme qu’elle me donne à cet
égard, je fais l’étonnement de ma mère, d’Émile, et de tous ceux qui
me connaissent. On se demande comment le Maurice inquiet et si turbulent de
nature peut s’immobiliser pendant des heures entières sur une berge
monotone en face d’une eau toujours la même. Je n’essaierai pas d’expliquer
ma passion pour la pêche à la ligne. J’en raffole, voilà tout !
– Pourquoi ? – sans doute, parce que je hume toute l’étrangeté
qui se dégage d’une rivière dormante jusqu’à sembler morte, ou que
les émanations rafraîchissantes d’une eau torrentueuse magnétisent et
engourdissent mes névroses. C’est avec une perfidie si savoureuse que le
pêcheur-poëte s’installe au bord d’une nappe d’eau inerte émaillée
çà et là de nénuphars, en pleine solitude, sur un tertre semé de
menthes sauvages, sous des ramées centenaires tamisant le flambant
azur !...
(…) » (collection particulière).
Quelques années plus tard, il raconte ses vacances à Bel-Air à Raoul Lafagette et nous pouvons lire dans une lettre datée du 14 septembre 1877 :
« (…)
La pêche, dont je raffole, est ma principale occupation.
J’ai des soupirs de remords à chaque poisson que j’enlève, mais je me
dis qu’ils mangeaient le ver, lequel mangeait le sol, et me voilà absous
de vouloir dévorer ces infortunés gougeons (sic), tant il est vrai
que l’homme se sert de tous les prétextes pour justifier à ses propres
yeux son abominable barbarie. (…) » (collection particulière).
Cette passion lui inspire le poème suivant où on retrouve de nombreux points communs avec ses lettres comme la patience ou la pêche de goujons :